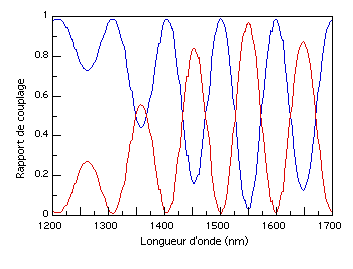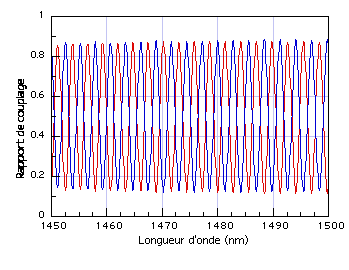Menu
Général
URL: http://opt-fibres.phys.polymtl.ca/Fibres_html/Fibres.html
Menu
Général
URL: http://opt-fibres.phys.polymtl.ca/Fibres_html/Fibres.html




Suivant:Miroirs
en boucleHaut:Structures
Mach-ZehnderPrécédent:Structures
soustractives
6.1.3 Multiplexeurs denses insensibles
à la polarisation
Tel que mentionné à la section 5.3.3,
les réponses spectrales des coupleurs très étirés
dépendent trop de la polarisation pour être utilisables au
multiplexage. Pour remédier à ce problème, on peut
exploiter la réponse spectrale d'un Mach-Zehnder tout-fibre fortement
déséquilibré. Les coupleurs 3 dB peuvent être
peu étirés, c'est-à-dire avec 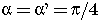 ,
pour qu'ils dépendent peu de la polarisation. La réponse
spectrale de la structure est alors esssentiellement déterminée
par la différence de marche entre les deux bras de l'interféromètre.
Si les fibres ne sont pas biréfringentes, le déphasage correspondant
,
pour qu'ils dépendent peu de la polarisation. La réponse
spectrale de la structure est alors esssentiellement déterminée
par la différence de marche entre les deux bras de l'interféromètre.
Si les fibres ne sont pas biréfringentes, le déphasage correspondant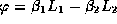 est indépendant de la polarisation.
est indépendant de la polarisation.
Pour réaliser une telle structure M-Z, deux approches sont possibles
: soit les longueurs géometriques et
et des bras de l'interféromètre
sont égales et les constantes de propagation
des bras de l'interféromètre
sont égales et les constantes de propagation et
et différentes; soit
les longueurs sont différentes et les constantes de propagation
égales. Dans le premier cas, l'asymétrie peut être
obtenue par effilage adiabatique de l'un des bras, auquel cas l'intervalle
spectral est limité par l'élongation. En gardant une longueur
raisonnable pour le composant (
différentes; soit
les longueurs sont différentes et les constantes de propagation
égales. Dans le premier cas, l'asymétrie peut être
obtenue par effilage adiabatique de l'un des bras, auquel cas l'intervalle
spectral est limité par l'élongation. En gardant une longueur
raisonnable pour le composant ( cm) nous avons obtenu un intervalle
cm) nous avons obtenu un intervalle  nm et considérons que la limite de cette technique est de
nm et considérons que la limite de cette technique est de  nm [30]. Le résultat expérimental
est montré à la figure 6.6.
La deuxième technique, avec une différence de longueur de
l'ordre de 0,7 mm, nous avons obtenu
nm [30]. Le résultat expérimental
est montré à la figure 6.6.
La deuxième technique, avec une différence de longueur de
l'ordre de 0,7 mm, nous avons obtenu  nm (voir figure 6.7), qui pourrait
être encore diminué en utilisant des différences de
longueur plus grandes. Cette dernière technique est donc prometteuse
pour une densité de multiplexage arbitraire bien qu'elle donne lieu
à des encombrements a priori plus grands (
nm (voir figure 6.7), qui pourrait
être encore diminué en utilisant des différences de
longueur plus grandes. Cette dernière technique est donc prometteuse
pour une densité de multiplexage arbitraire bien qu'elle donne lieu
à des encombrements a priori plus grands ( cm) et par conséquent une stabilité médiocre. Il faut
aussi noter que pour une performance maximale, un interféromètre
de M-Z requiert deux coupleurs 3 dB identiques et indépendants de
la longueur d'onde; sinon, la transmission ou/et l'isolation peuvent être
affectées.
cm) et par conséquent une stabilité médiocre. Il faut
aussi noter que pour une performance maximale, un interféromètre
de M-Z requiert deux coupleurs 3 dB identiques et indépendants de
la longueur d'onde; sinon, la transmission ou/et l'isolation peuvent être
affectées.
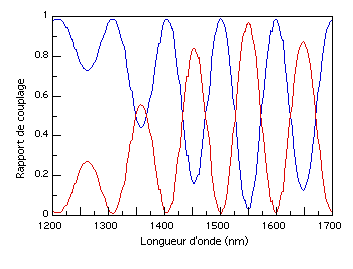
Figure 6.6: Réponse spectrale d'un interféromètre
Mach-Zehnder utilisé en multiplexeur. Le déphasage est créé
par effilage adiabatique de l'un des deux bras.
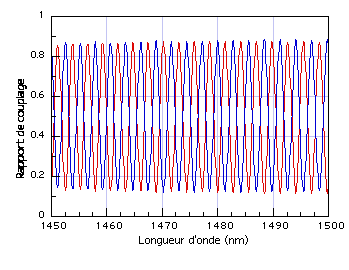
Figure 6.7: Réponse spectrale d'un interféromètre
Mach-Zehnder utilisé en multiplexeur. Le déphasage est créé
par une différence de longueur des deux bras.




Suivant:Miroirs
en boucleHaut:Structures
Mach-ZehnderPrécédent:Structures
soustractives
Copyright 1995 Suzanne Lacroix
Lun Jul 3 16:05:57 1995
 et
et des bras de l'interféromètre
sont égales et les constantes de propagation
des bras de l'interféromètre
sont égales et les constantes de propagation et
et différentes; soit
les longueurs sont différentes et les constantes de propagation
égales. Dans le premier cas, l'asymétrie peut être
obtenue par effilage adiabatique de l'un des bras, auquel cas l'intervalle
spectral est limité par l'élongation. En gardant une longueur
raisonnable pour le composant (
différentes; soit
les longueurs sont différentes et les constantes de propagation
égales. Dans le premier cas, l'asymétrie peut être
obtenue par effilage adiabatique de l'un des bras, auquel cas l'intervalle
spectral est limité par l'élongation. En gardant une longueur
raisonnable pour le composant ( cm) nous avons obtenu un intervalle
cm) nous avons obtenu un intervalle  nm et considérons que la limite de cette technique est de
nm et considérons que la limite de cette technique est de  nm [30]. Le résultat expérimental
est montré à la figure 6.6.
La deuxième technique, avec une différence de longueur de
l'ordre de 0,7 mm, nous avons obtenu
nm [30]. Le résultat expérimental
est montré à la figure 6.6.
La deuxième technique, avec une différence de longueur de
l'ordre de 0,7 mm, nous avons obtenu  nm (voir figure 6.7), qui pourrait
être encore diminué en utilisant des différences de
longueur plus grandes. Cette dernière technique est donc prometteuse
pour une densité de multiplexage arbitraire bien qu'elle donne lieu
à des encombrements a priori plus grands (
nm (voir figure 6.7), qui pourrait
être encore diminué en utilisant des différences de
longueur plus grandes. Cette dernière technique est donc prometteuse
pour une densité de multiplexage arbitraire bien qu'elle donne lieu
à des encombrements a priori plus grands ( cm) et par conséquent une stabilité médiocre. Il faut
aussi noter que pour une performance maximale, un interféromètre
de M-Z requiert deux coupleurs 3 dB identiques et indépendants de
la longueur d'onde; sinon, la transmission ou/et l'isolation peuvent être
affectées.
cm) et par conséquent une stabilité médiocre. Il faut
aussi noter que pour une performance maximale, un interféromètre
de M-Z requiert deux coupleurs 3 dB identiques et indépendants de
la longueur d'onde; sinon, la transmission ou/et l'isolation peuvent être
affectées.




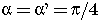 ,
pour qu'ils dépendent peu de la polarisation. La réponse
spectrale de la structure est alors esssentiellement déterminée
par la différence de marche entre les deux bras de l'interféromètre.
Si les fibres ne sont pas biréfringentes, le déphasage correspondant
,
pour qu'ils dépendent peu de la polarisation. La réponse
spectrale de la structure est alors esssentiellement déterminée
par la différence de marche entre les deux bras de l'interféromètre.
Si les fibres ne sont pas biréfringentes, le déphasage correspondant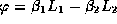 est indépendant de la polarisation.
est indépendant de la polarisation.