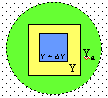
2 LUMINOSITÉ DES PLAGES NON TRÈS PETITES
2.1 Conditions de l'observation *
2.2 Seuil différentiel de luminance *
2.3 Echelle de sensation et réponse de transfert *
2.4 Réponse CLARTÉ - LUMINANCE *
2.1 Conditions de l'observation
L'œil apprécie la qualité d'une image en particulier par la reconnaissance des variations de luminance qui soulignent les formes, et, par l'intermédiaire des demi-teintes, qui donnent le contraste maximal entre les parties les plus lumineuses, les blancs et les parties les moins lumineuses, les noirs. Cette appréciation de la modulation de la lumière se fait sur des plages de faibles dimensions mais l'œil adapte sa sensibilité sur la luminance moyenne globale de l'image et, lorsque cette image est une faible partie du champ visuel, sur la luminance de l'image corrigée par l'action de la luminance du champ périphérique.
L'étude de la réponse de transfert de l'œil est menée dans des conditions d'adaptation fixes, caractérisées par une luminance d'adaptation : Ya
L'appréciation des luminances sera faite sur une plage de l'image suffisamment grande pour éviter l'influence de la réponse d'ouverture, mais assez petite pour ne pas influencer l'adaptation. Si le signal d'entrée peut ainsi être bien défini (i e : de manière objective), il n'en est pas de même pour le signal reçu (l'impression de luminosité) qui est une sensation subjective. Tous les résultats que l'on peut obtenir des essais seront influencés par la dispersion des appréciations des opérateurs et des sensibilités réelles des yeux. Les résultats montrent que cette dispersion est importante.
2.2 Seuil différentiel de luminance
Une technique classique pour apprécier la réponse de l'œil consiste à déterminer les seuils différentiels de luminance sur une mire. La plupart des essais sont effectués en vision directe de la mire objet éclairée.
Le test se compose d'une plage A, de faibles dimensions, placée au milieu d'une plage B assez grande, elle-même placée dans un champ d'image de luminance constante Ya considérée comme luminance d'adaptation. La luminance de B étant fixée à la valeur Y, la luminance est amenée de Y pour laquelle A est indiscernable dans B, à la valeur Y + DY pour laquelle A devient juste discernable par l'opérateur.
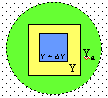
D
Les essais montrent que DY dépend de Y. On considère comme caractéristique la fraction de Weber DY/Y. Dans un tel essai (à adaptation constante), Y varie à partir d'un minimum correspondant à la première valeur Y0 = DY pour laquelle la plage se distingue du noir absolu. Cette première valeur Y0 est la limite du noir subjectif. En dessous de cette luminance, l'œil ne reconnaît plus aucune nuance.
La valeur maximale de Y est mal définie, elle correspond à une valeur pour laquelle Y commence à influencer sérieusement l'adaptation. De plus, pour être réaliste vis-à-vis des images ou objets réels, le contraste maximal C=Ymax/Y0 n'est pas utilement supérieur à 500.
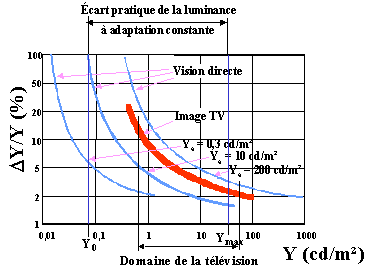
Fig. 2.1 : variation de la fraction de Weber dans différents cas
La figure 2.1 donne l'allure de la variation de la fraction de Weber pour une adaptation à lumière relativement faible (caractéristique des conditions d'observation de la télévision). La courbe montre que :
1°) pour Y élevé, DY/Y tend vers une constante comprise entre 0,01 et 0,02.
2°) pour Y faible, DY/Y croit. La valeur unité serait atteinte pour le premier échelon de luminance décelable (soit Y = Y0).
Des résultats de mesure de la fraction de Weber sur une image de télévision (tube image) font apparaître une pente légèrement plus faible et un niveau de palier plus proche de 0,02.
2.3 Echelle de sensation et réponse de transfert
Du fait de l'écart fini DY qui sépare les luminances de 2 plages voisines tout juste discernables par l'œil, le nombre de tels échelons de luminance DY est calculable entre 2 valeurs Y1 et Y2 des luminances.
On en a en effet pour nombre d'échelons N : 
soit : 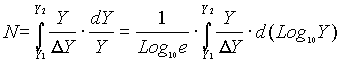
Cette relation conduit à une intégration facile sur la fonction y = Y/DY donnée en fonction de Log10Y. On obtient :
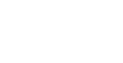
La figure 2.2 donne le résultat de cette intégration pour les courbes DY/Y présentées par la figure 2.1.
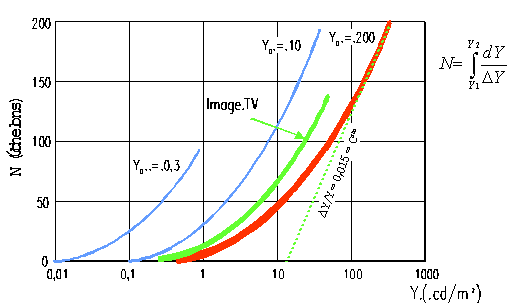
Fig. 2.2 : Nombre d'échelons de luminance perçus pour différentes adaptations
Remarques
Les essais montrent que ces courbes, tout en conservant la même forme générale, dépendent beaucoup des conditions du test.
Citons quelques effets :
- l'uniformité du champ environnant influence la valeur limite de DY/Y.
- la luminance d'adaptation joue sur le point de départ de la courbe, désigné par "noir subjectif" ; les figures 2.1 et 2.2 sont significatives de cet effet.
- la dimension de la plage de test a de l'influence lorsqu'elle devient très petite, c'est à dire vue sous un angle inférieur à 2°. La valeur de DY/Y augmente lorsque la taille de la plage diminue, tout se passe comme si l'œil exerçait un effet de filtrage en atténuant les transitions pour les fréquences élevées.
D'autre part, le temps d'observation influence le discernement de DY comme si l'œil nécessitait une accumulation de stimulus.
2.4 Réponse CLARTÉ - LUMINANCE
La courbe 2.3 montre que la sensation de luminosité (grandeur subjective) d'un objet n'est pas proportionnelle à la luminance photométrique (grandeur objective) ; on désigne par clarté (notée W*) cette sensation.
La valeur attribuée à la clarté d'une plage en demi-teinte dépend de la luminance de celle-ci mais aussi de l'environnement. On a cherché à donner une réponse normalisée pour l'observateur de référence :
![]() (norme CIE 1964)
(norme CIE 1964)
dans laquelle Y est la luminance avec, sous-entendu, l'hypothèse que la luminance Y = 100 cd/m2 est associée à la valeur voisine de W* = 100 de la clarté.
Par ailleurs, on a défini la clarté psychométrique comme étant :
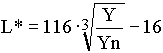 avec Y/Yn > 0,01 (norme CIE 1976)
avec Y/Yn > 0,01 (norme CIE 1976)
Dans cette expression, Yn est la luminance de la couleur de la surface choisie comme stimulus blanc nominal. Une valeur de 100 cd/m2 est très réaliste pour une application à la télévision (standard actuel) ; ainsi le blanc nominal correspondra à L* = 100.
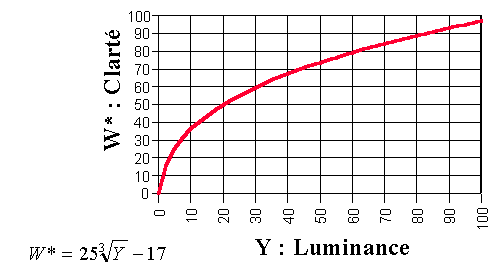
Fig. 2.3 : Réponse Clarté - Luminance
Les formules de la CIE ayant été établies lors de visions directes d'objets éclairés, leurs résultats ne sont pas toujours applicables au domaine de la télévision.
Certaines études menées sur des images de télévision tendent à considérer l'expression ![]() mais faute de résultats cohérents, la formule de la CIE reste applicable.
mais faute de résultats cohérents, la formule de la CIE reste applicable.
Alors que la clarté d'une plage dépend de la luminance de l'environnement, la restitution de la teinte semble y être insensible.
Index Précédent Suivant Accueil