3 ACUITÉ VISUELLE EN LUMINANCE
3.1 Réponse d'ouverture de l'œil *
3.1 Réponse d'ouverture de l'œil
L'optique de l'œil donne pour image d'un point objet un spot de diffraction dont la partie principale a un diamètre voisin de ![]() avec :
avec :
f : distance focale de l'œil (17 mm)
D : diamètre de la pupille (3 mm)
Ainsi pour l = 550 nm, le spot a un diamètre de 6,6 µm environ.
En fait, il faut ajouter le spot équivalent aux anneaux de la figure de diffraction et une part de lumière diffuse. Les aberrations apportent également leur contribution. On estime que la réponse d'ouverture est équivalente à celle d'un spot circulaire de densité constante de diamètre voisin de 20 µm donnant une réponse d'ouverture dont la facteur de réponse rectangulaire G prend la valeur 0,5 pour une fréquence spatiale de la mire de Foucault, sur la rétine, voisine de 50 lignes/mm.
La réponse d'ouverture est également influencée par le fait que les cônes de la rétine n'agissent pas de manière indépendante mais sont, en un point donné, associés par les fibres optiques en un essaim ayant une surface nettement supérieure à leur surface propre. Cette association dépend du point de la rétine et dégrade tout particulièrement la réponse de l'œil en dehors de la zone fovéale.
Enfin il existe un effet de contre-réaction entre les cellules voisines qui se manifeste, de chaque côté d'une transition noir-blanc, par un effet de dérivation augmentant le contraste apparent de la transition (bandes de Mach) ; cet effet de bord apporte une contribution à la réponse d'ouverture pour les faibles fréquences spatiales.
La réponse d'ouverture réelle de l'œil s'exprime en sensation et n'est donc pas mesurable. Les mesures ne peuvent être que des mesures indirectes généralement basées sur la limite de reconnaissance des barres de la mire de Foucault ou d'un détail caractéristique d'un optotype, comme l'anneau de Landolt.
Le principe est le même que pour l'appréciation de la réponse de transfert pour l'étude des échelons de luminance.
Les essais sur optotypes se basent sur l'observation d'une dimension caractéristique de l'optotype qui est soit la largeur d'une ligne de la mire de Foucault, soit l'ouverture de l'anneau de Landolt. La figure 3.1 montre que l'œil voit la dimension caractéristique S sous un angle a. A la limite de visibilité de l'optotype, cet angle prend une limite a0.
On nomme acuité visuelle la valeur Av = 1/a0 où a0 est exprimé en minutes d'angle.
Deux autres unités sont utilisées lorsque l'optotype est la mire de Foucault :
La fréquence spatiale fs (en lignes/mm) est utilisée pour caractériser l'image sur la rétine, ou sur la mire.

Fig. 3.1 : Définition des optotypes
Le nombre de lignes dans la hauteur de l'image N est une unité caractéristique de la télévision ; cette unité suppose que la mire de Foucault, horizontale, occupe toute la hauteur d'une image regardée à une distance d et de hauteur V. Pour la mesure, on utilise comme paramètre la distance relative d'observation dob (dob = d/V), souvent compris entre 4 et 6 pour la télévision standard.
La valeur de N est le nombre de lignes noires dans la hauteur de l'image ; la figure 3.1 donne la géométrie qui réunit les 3 unités, à savoir :
Angle en radians : ![]()
Angle en minutes : a(') = 3430.a(rd)
Acuité visuelle : 
![]()
En particulier, pour ![]() =4, on obtient :
=4, on obtient : ![]()
La fréquence spatiale est : ![]() en lignes/mm
en lignes/mm
Il est pratique également de caractériser la vision de la mire par la fréquence spatiale visuelle fV (en cycles/°) correspondant au nombre de périodes spatiales vues sous un angle de 1°. Une mire de fréquence visuelle fV correspond à une valeur AV = 30/fV de l'acuité visuelle.
3.2 Acuité visuelle sur optotypes
La mire de Foucault et l'anneau de Landolt sont l'optotype les plus fréquemment utilisés pour apprécier l'acuité visuelle ; la limite correspond à la reconnaissance de la structure rayée pour la mire et à la position de la coupure pour l'anneau.
Les résultats dépendent des conditions d'adaptation (luminance du champ périphérique), de la luminance du blanc Yb et du contraste caractérisé par la valeur M = (Yb - Yn)/Yb où Yn est la luminance de la zone sombre ; ces 2 facteurs sont très importants et la figure 3.2 montre une série de résultats obtenus.
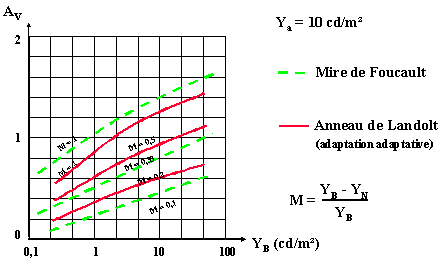
Fig. 3.2 : Variations de l'acuité sur mires optotypes
Les expériences sur la reconnaissance des optotypes associent la valeur limite de l'acuité visuelle à une certaine profondeur de modulation limite de l'image lumineuse sur la rétine, limite qu'il n'est pas nécessaire de préciser car le résultat dépend aussi de la réaction nerveuse.
Pour des mires à très basse fréquence spatiale, c'est à dire pour des plages larges, il est normal que la reconnaissance corresponde à un contraste DY/Y égal à la fraction de Weber. En prenant comme valeur limite DY/Y = 0,015, cette valeur correspond à -36 dB, en accord avec les mesures effectuées en télévision sur une structure d'interférence fixe sur l'image.
Lorsque la fréquence spatiale augmente, il y a d'abord une certaine augmentation de l'acuité visuelle ; cette augmentation est la conséquence des liaisons entre les cellules nerveuses et la rétine qui améliorent, par contre-réaction, le contraste au voisinage des transitions.
La profondeur de modulation limite diminue d'environ 6 dB pour une fréquence spatiale correspondant à une valeur de N un peu inférieure à 100 lignes. L'interprétation de la réponse de l'œil peut être présentée de diverses manières :
Les résultats donnés sur la figure 3.2 correspondent à des essais effectués à adaptation variable sur la luminance du blanc qui constitue le fond de la plage d'observation.
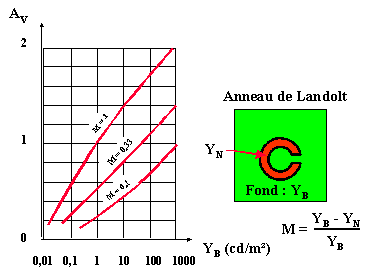
Fig. 3.3 : Variations de l'acuité visuelle sur les anneaux de Landolt
La figure 3.4 donne une interprétation de la relation entre acuité visuelle et profondeur de modulation qui se vérifie pour plusieurs types d'optotypes.
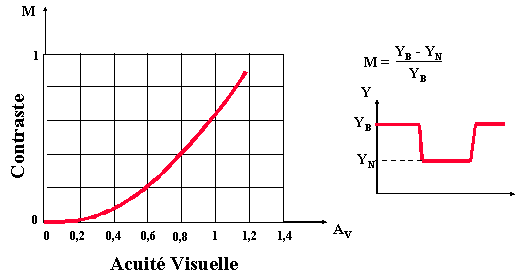
Fig. 3.4 : Fonction de réponse d'ouverture de l'œil (1/M0 = 120 à 140)
Une analyse plus fine de l'acuité visuelle pour des faibles contrastes est obtenue en prenant pour ordonnée l/M ; on trouve la présence d'un maximum correspondant à un contraste M0 avec 1/M0 de l'ordre de 120 à 140 (soit 45 dB). La courbe 3.5 représente les variations du rapport M/M0 avec AV, courbe que l'on peut considérer comme constituant la réponse d'ouverture de l'œil.
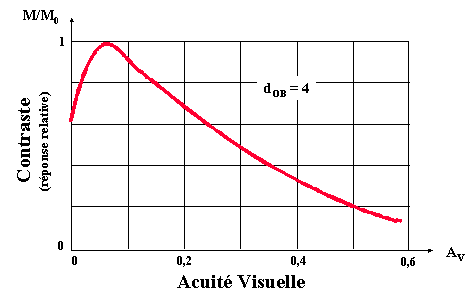
Fig. 3.5 : Réponse d'ouverture de l'œil
Pour les fréquences spatiales croissant au-delà de ce maximum d'acuité visuelle, 2 phénomènes se conjuguent pour diminuer l'acuité, ce qui conduit à une valeur DY/Y de plus en plus grande pour la limite de reconnaissance de la mire.
Il est à noter que :
- d'une part, la réponse d'ouverture de l'optique de l'œil diminue le contraste de la mire sur la rétine,
- d'autre part, l'acuité réelle de la rétine diminue rapidement lorsque la fréquence spatiale augmente du fait des interactions entre les neurones.
Ces "effets de bord" (bandes de Mach) sont représentés par la figure 3.6, la clarté manifeste, aux transitions, un effet de dépassement qui accroît le contraste apparent de la transition (si cette dernière a une raideur suffisante).
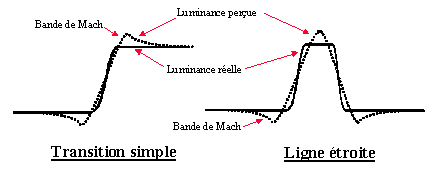
Fig. 3.6 : Effets de bord dans la vision des transitions de luminance
Ce phénomène a pour conséquence d'améliorer la finesse apparente d'une image lorsque le contraste augmente ; cela est très favorable, dans les conditions d'observation de la télévision.
3.4 Influence de divers facteurs
a) Influence du champ visuel
La réponse dépend de la dimension du champ visuel, comme le montre la figure 3.7 où sont portés les résultats obtenus avec des champs de 2° et de 10° ; les effets des interactions nerveuses dans la rétine s'étendent donc sur une assez grande surface puisque, dans les 2 cas, le test est effectué en vision fovéale.

Fig 3.7 : Effets divers influençant la réponse d'ouverture
b) Influence de l'orientation de la mire
La vision n'est pas isotrope ; certains essais tendent à montrer que le pouvoir de résolution est maximal pour une mire horizontale ou verticale et diminue avec l'inclinaison, pour être minimal pour un angle de 45 ° ; la perte de sensibilité pourrait atteindre 50 %.
c) Influence du mouvement de la mire sur l'acuité visuelle
La réaction sensorielle a une certaine inertie, de l'ordre de 0,1 s qui est mise en évidence, par exemple, par la vision des étoiles filantes vues comme un trait lumineux, ou encore la disparition du papillotement pour les éclairements modulés.
Lorsque l'optotype observé est mis en mouvement assez rapide devant l'observateur, l'acuité visuelle diminue. Quelques expériences menées sur les anneaux de Landolt montrent que cette diminution est sensiblement linéaire avec la vitesse de déplacement ; AV est diminué par 2 pour une vitesse angulaire de 50 à 60°/s.
Cependant, pour des vitesses de déplacement faibles,, l'effet est opposé : l'acuité visuelle augmente ; le déplacement favorise le processus de réactivation sensorielle de la rétine qui est, sur des images fixes, obtenu par des déplacements instinctifs de l'œil lui-même.
d) Influence de l'excentricité de la vision
L'acuité visuelle est maximale sur l'image qui se forme dans la zone fovéale de la rétine ; c'est dans cette zone que la finesse d'analyse de l'image par les cônes est la plus grande par suite de la faible dépendance des cellules entre elles. Par contre, en s'éloignant de cette zone, l'acuité visuelle diminue. Certains résultats indiquent que l'acuité visuelle est divisée par 2 pour un angle d'excentricité de 2° et divisé par 10 pour un angle d'excentricité compris entre 10 et 20°.
L'acuité visuelle élevée de la zone fovéale correspond à un angle de vision de 3° environ. L'acuité visuelle est jugée médiocre en dehors de cette zone ; cependant, psychologiquement, la sensation globale d'une image, principalement dans le cas d'une image artistique qui s'interprète aussi en terme de réalisme ou d'agrément, est inséparable de la perception du champ d'environnement de la zone fovéale.
L'observateur oriente le regard par un perpétuel mouvement de l'œil pour diriger l'axe fovéal vers la partie de l'image retenue pour une analyse fine. La zone proche constitue une zone de surveillance dont l'interprétation permet l'orientation rapide de l'œil vers tel détail choisi instinctivement malgré une acuité faible et sans mouvement de la tête. Cette recherche porte sur certains détails de l'image qui suscitent un acte intellectuel d'interprétation.
Une troisième zone, dite zone d'impression induite, renseigne sur la structure des grandes masses de l'image et surtout de leur mouvement, ce qui peut induire l'orientation volontaire du regard par le mouvement conjugué de la tête et du globe oculaire.
Enfin la zone de vision latérale, jusqu'à la limite géométrique de la zone perçue, participe encore à l'appréciation de l'espace et, en particulier de la présence d'objets en mouvement rapide, incitant, par exemple des réactions de défense ou de réponse. La figure 3.8 montre la dimension angulaire des différentes zones citées, pour un œil immobile.
En pratique, si le mouvement du globe oculaire est permanent et rapide, ce mouvement est angulairement limité et le mouvement de la tête vient ensuite compléter l'orientation avant que le corps entier ait à participer à la recherche de l'image. Pour une recherche cadrée, tenue sur une durée assez longue, la tête s'oriente pour centrer la recherche angulaire. Pour une recherche temporaire, il y a conjugaison d'une rotation de la tête limitée et complétée par une rotation moyenne du globe oculaire. La figure 3.8 montre les valeurs angulaires approximatives de ces mouvements.
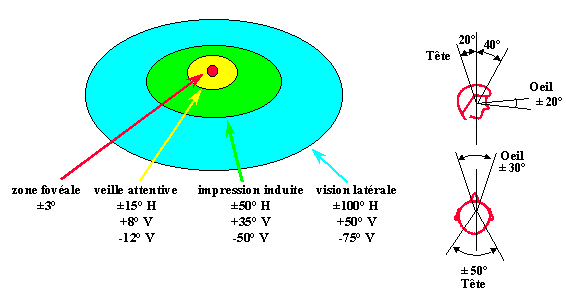
Fig. 3.8 : Zones d'action de la vision oculaire Index Précédent Suivant Accueil