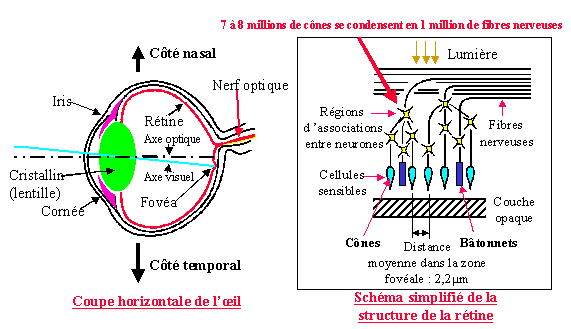
Fig 1.1 : Structure de l'œil et de la rétine
1.1 Contextes usuels de luminance *
1.2 adaptation de l'œil *
1.3 fonctionnement sensoriel de la rétine (notions de base) *
Du fait de la grande plage de luminance rencontrée dans les scènes naturelles, l'œil possède une forte capacité d'adaptation :
Gamme des éclairements courants :
|
Soleil à 50 ° au-dessus de l'horizon par ciel clair |
105 |
Lux |
|
Eclairage artificiel intense |
103 à 104 |
Lux |
|
Eclairage de bureau |
500 |
Lux |
|
Eclairage de circulation de nuit |
50 |
Lux |
|
Eclairage minimal de circulation |
0,1 à 1 |
Lux |
|
Pleine lune |
0,2 |
Lux |
|
Limite d'appréciation des formes |
10-2 à 10-3 |
Lux |
La gamme des éclairements précédents ne se rencontre jamais toute entière dans une scène réelle. Les variations de luminance d'un objet donné sont dues d'une part aux variations d'éclairement, atténuées par les lumières réfléchies et, d'autre part par les variations de réflectance, les noirs n'étant jamais à réflectance nulle.
Pour des scènes naturelles, éclairées par la lumière du jour, le contraste peut évoluer de 30 pour des scènes à éclairage faible très diffusé à 1000 pour des éclairages intenses. Une valeur moyenne de 100 à 200 est normale.
Les luminances d'objets considérés comme étant bien éclairés varient de quelques Candela par mètre carré à quelques dizaines de milliers de cd/m2.
Pour répondre à ces domaines d'éclairement et de contraste, l'œil s'adapte à la luminance moyenne présente dans son champ de vision (lumière d'adaptation) et ce par 2 processus distincts :
a) par réaction instinctive, le diamètre de la pupille varie en fonction de la lumière d'adaptation en diminuant lorsque celle-ci augmente. Cela équivaut à restreindre la plage de luminance perçue.
b) par une variation de la sensibilité moyenne de la rétine qui traduit d'une manière non linéaire l'éclairement en sensation de luminosité (effet Stiles-Crowford).
La correction de sensibilité se fait de manière progressive, lorsque l'éclairement moyen d'adaptation varie brusquement, l'œil met un certain temps à s'adapter ; ce temps peut être de l'ordre de la minute, voire plus.
1.3 fonctionnement sensoriel de la rétine (notions de base)
La rétine constitue le traducteur IMAGE-INFLUX nerveux ; les cellules sensibles sont de 2 types :
Ils agissent en vision photopique, c'est à dire lorsque la luminosité est moyenne à forte, et sont regroupés en 3 groupes mêlés dont les sensibilités spectrales complémentaires permettent l'interprétation trichrome des couleurs. Les cônes sont essentiellement regroupés dans la région située dans l'axe optique de l'œil, la fovéa ; la distance moyenne les séparant y est d'environ 2,2 µm.
Ils permettent la vision scotopique, c'est à dire lors des faibles éclairements. La sensibilité scotopique de l'œil est maximale pour une longueur d'onde de 500 nm alors qu'en vision photopique, le maximum se situe aux alentours de 550 nm.
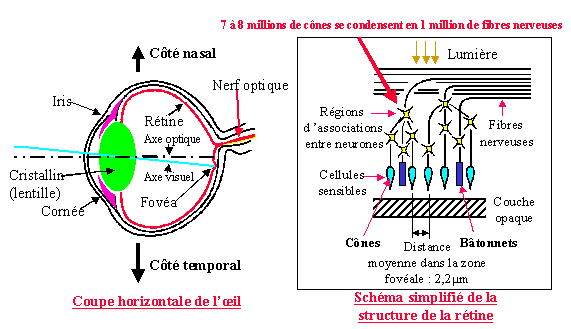
Fig 1.1 : Structure de l'œil et de la rétine
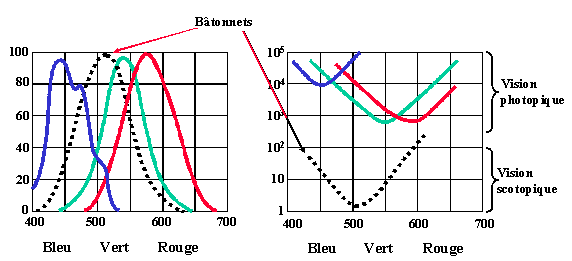
Fig. 1.2 : Sensibilités relatives des cônes et des bâtonnets
Il est important de noter que l'influence des cellules en bâtonnets n'est importante que pour la vision scotopique.
Il y a une très forte concentration de cônes dans la fovéa qui décroît très rapidement, et symétriquement, en vision périphérique. Pour les bâtonnets, il en va tout autrement car ils sont virtuellement absents dans la zone fovéale pour apparaître aux alentours de 15°, du côté nasal.
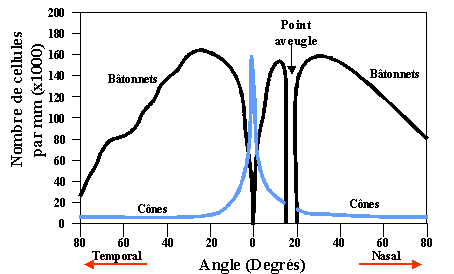
Fig 1.3 : Distribution des récepteurs dans la rétine
Les neurones associés aux cônes se groupent dans plusieurs couches intermédiaires avec une réduction du nombre de neurones jusqu'à la fibre du nerf optique qui transmet au cerveau l'information captée par les cônes.
Ces groupements sont de plus en plus importants en s'éloignant de la zone fovéale. Dans cette dernière, le nombre de nerfs est voisin de celui des cônes alors qu'en périphérie, un seul nerf correspond à de nombreux cônes ; ainsi, 7 à 8 millions de cônes se condensent en 1 million de fibres nerveuses.
Les groupements de cellules et les relations latérales plus ou moins complexes qui existent entre cellules voisines créent des contre-réactions qui influencent la traduction sensorielle de la vision.
L'excitation des nerfs étant dynamique, l'excitation des cônes doit être continument variable ; cela se fait de manière instinctive par des déplacements angulaires rapides et de faible amplitude du globe oculaire. Index Suivant Accueil