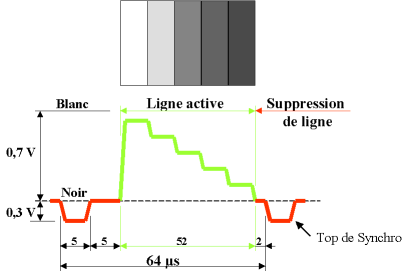
Fig. 3.1 : Détail d'une ligne vidéo monochrome
3.2 Signal vidéo composite (couleur)
*
Le signal électrique transmis a été spécifié lors de la création des premiers systèmes de diffusion télévisuelle, c'est à dire il y a au moins 50 ans. A l'époque (dans les années 30), la technologie n'offrait pas autant de performances que de nos jours et, d'un autre côté, la télévision s'adresse à un marché "Grand Public" ; ainsi, le signal vidéo a été conçu dans un but de simplicité de décodage.
Le signal, présenté par la figure suivante pour une ligne vidéo, est composé de 2 parties :
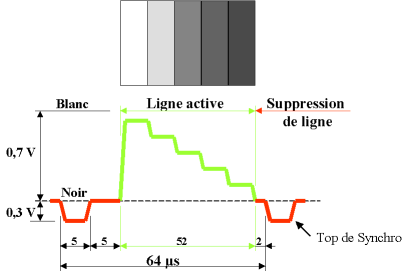
Fig. 3.1 : Détail d'une ligne vidéo monochrome
La figure précédente présentant le détail d'une ligne d'une image de télévision 625 lignes avec un cadencement de trames à 50 Hz, on vérifie bien que la durée d'une ligne est de 64 µs (fréquence ligne (fH) de 15625 Hz) ; la partie utile (visible) de la ligne dure 52 µs, ce qui laisse 12 µs pour la synchronisation.
La transmission du signal vidéo fait que le récepteur ne reçoit pas la composante continue du signal, il faut donc le recréer ; cette opération, dénommée "clamp" consiste à aligner le signal reçu sur le niveau de noir pendant les 5 µs qui suivent le top de synchro (temps pendant lequel le signal est constant (palier)).
Une autre composante à régénérer, à la réception, est l'amplitude du signal par contrôle automatique du gain ; cette opération est réalisée en mesurant l'amplitude du top de synchro, qui est indépendante du contenu de l'image.
La figure suivante présente le détail du signal vidéo pour la synchronisation verticale de l'image (synchro trame).
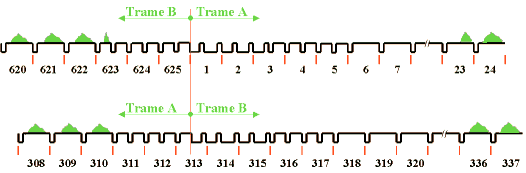
Fig. 3.2 : Détail de synchro trame
La récupération de la synchronisation de trame exploite l'inversion du top de synchro pendant 2,5 lignes : l'impulsion négative devient positive, la valeur moyenne décroit, il suffit alors d'un filtre passe-bas pour extraire le top de synchro trame.
La télévision exploite le mode de représentation de la couleur sous forme composantes Luminance - Chrominance (Y - C), où C est décomposé en 2 éléments, la différence ROUGE (DR) et la différence BLEU (DB) ; la figure suivante présente ces signaux pour la génération d'une mire de barres couleur.
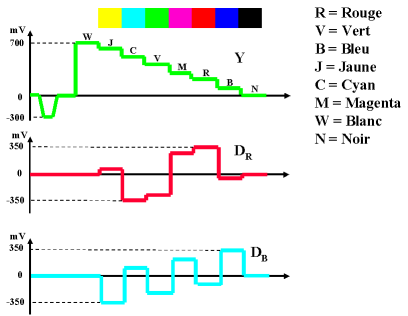
Fig. 3.3 : Mire de barres couleur
Le transport de l'information couleur par le signal vidéo a été fait de manière à rester compatible avec le parc de récepteurs N&B de l'époque (années 50, aux USA). Il existe plusieurs standards de codage de la couleur mais tous exploitent le même format de signal (figure suivante).
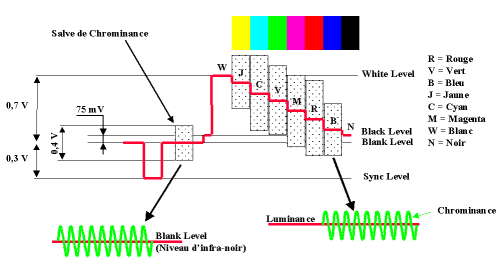
Fig. 3.4 : Mire de barres couleur
Le signal de chrominance est superposé au signal de luminance (multiplexage fréquentiel), il est transposé en fréquence par modulation d'amplitude ou de fréquence suivant le système. Le spectre du signal composite ainsi obtenu est présenté par la figure suivante.
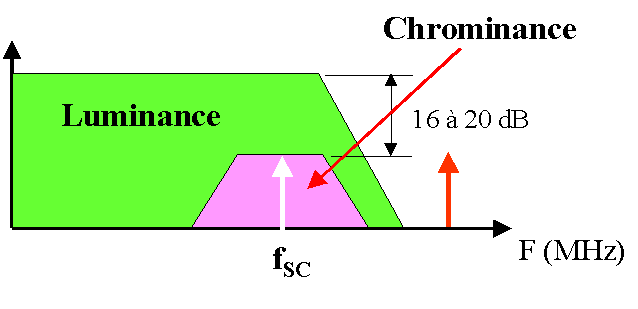
Fig. 3.5 : Mire de barres couleur
Index Précédent Suivant Accueil