| Dossier Technique N°22 | Janvier 2000 | ||
De nombreux chefs opérateurs, séduits par les possibilités de l'étalonnage numérique en vidéo, souhaiteraient bénéficier des mêmes fonctionnalités en film. Plusieurs laboratoires étudient la mise en place des équipements nécessaires. Nous avons interrogé sur ce sujet Daniel Borenstein, qui a développé un logiciel spécifique pour l'étalonnage numérique des films à GTC. Ce tour d'horizon des contraintes techniques et des moyens à mettre en œuvre reprend les principaux éléments de sa réflexion. Nous examinerons, ici, le cas des films tournés et projetés en 35 mm que l'on souhaiterait travailler entièrement en numérique.
A la date où nous écrivons (Nov. 99), quasiment aucun long métrage n'a été étalonné en numérique en France. A notre connaissance, une société située à Copenhague (Destiny 601), a déjà étalonné en numérique trois longs métrages Danois. Aux Etats Unis, Cinésite (Kodak), a installé un système d'étalonnage en numérique et travaille sur plusieurs long-métrages. Pour des raisons de rapidité ils utilisent deux scanners de type Spirit Dataciné et deux imageurs laser qui seront doublés dans un futur proche. Lucas Film a par ailleurs étalonné en numérique " Episode One " pour la copie destinée à la projection numérique (en fait deux versions ont été faites, une pour chaque type de projecteur).
Tout d'abord
l'étalonnage qu'est-ce que c'est ? L'étalonnage consiste
à donner une unité de couleur à des plans tournés
à des moments différents, pour qu'en projection ils donnent
l'impression d'avoir été tournés dans la continuité
de l'histoire. Cette opération est effectuée dans le laboratoire
en jouant sur les proportions de lumière rouge, verte et bleu lors
du tirage de l'élément intermédiaire. Les valeurs
de correction sont déterminées, plan par plan, par l'étalonneur
et le chef-opérateur qui se réfèrent à une
projection 35 mm. Cet étalonnage permet de jouer sur l'équilibre
colorimétrique global de l'image. En vidéo numérique
il est, bien sûr, possible de faire la même chose, mais aussi
de modifier le contraste, la courbe de transfert (gamma) pour chaque primaire.
Des effets plus sophistiqués sont ensuite possibles comme de travailler
sur une zone de l'image avec des caches ou de n'intervenir que sur une
couleur pour modifier sa teinte et sa saturation et, à l'extrême,
la remplacer par une autre !
On voit tout de
suite le champ immense des possibilités créatives des interventions
numériques sur la couleur. Peut-on encore appeler cela de l'étalonnage
? De l'étalonnage " à effet " ou tout simplement des effets
spéciaux ? Il ne s'agit pas d'une simple question de vocabulaire
mais bien d'une question de budget, il est évidemment impossible
d'effectuer des prestations aussi différentes pour le même
prix et dans la même durée.
| Contraintes techniques |
|
Dans le cas le plus
fréquent aujourd'hui, d'un film tourné et projeté
en 35 mm, il faut numériser entièrement le négatif
(après un pré-montage), à l'aide d'un scanner ou d'un
télécinéma Haute Définition, travailler la
couleur sur une station de travail, et reporter l'ensemble sur pellicule
35 mm avec un imageur.
Le premier problème
à résoudre est l'énorme quantité de données
numériques que représente un long métrage, soit 1300
Giga Octets pour 90 minutes d'images.
Le poids des images
Pour mémoire, voici les ordres de grandeur des principaux types d'images couramment rencontrés (un film de 90 mn est constitué de 130 000 images).
|
|
|
|
|
|
|
360 points x 576 lignes en chrominance |
|
|
|
|
960 points x 1080 lignes en chrominance |
à 24 images/s (24P) |
|
|
|
|
|
|
Le temps nécessaire pour acquérir ces données (scanner) et les retransférer (imageur) sur pellicule en bout de chaîne est aussi un paramètre non négligeable.
Les temps de transfert
|
|
|
| Le plus lent |
|
| 25 secondes/image |
|
| Le plus rapide |
|
| 5 images/seconde |
|
|
|
|
|
|
|
| Le plus lent |
|
| 40 secondes/image |
|
| Le plus rapide |
|
| 3,5 secondes/image |
|
| Numérique... oui mais lequel ? |
|
Les effets spéciaux utilisent couramment des formats informatiques dits " data " disponibles en sortie de scanner. La résolution est de 2048 pixels par ligne (appelé 2K) ou 4096 (4K), numérisés en 8, 10 ou 12 bits par couleur primaire (rouge verte et bleue). Cette numérisation est soit linéaire, soit logarithmique au format Cineon créé par Kodak.
Le format le plus répandu aujourd'hui est 10 log Cineon (voir plus loin). Pour tous ces formats il n'existe pas de solution " temps réel ", ni pour les scanners, ni pour les traitements numériques, ni pour l'enregistrement de sauvegarde ou le retour sur film.
Dans ce contexte, un nouveau format numérique, dédié au grand écran, est en train de se généraliser. C'est l'un des formats TVHD (Télévision Haute Définition) numériques issus du passage à la télévision numérique aux USA. Aujourd'hui, ce format a dépassé le cadre typiquement américain pour devenir un format d'image commun.
En voici les principales caractéristiques :
Les différences entre ces deux formats se concrétisent dans les équipements qui les représentent. Les équipements haute définition, héritiers de la vidéo, sont temps réels, autant pour les télécinémas que pour les enregistreurs (magnétoscopes).
Pour atteindre le temps réel, il faut réduire le débit des informations à traiter, cela se fait essentiellement par trois moyens :
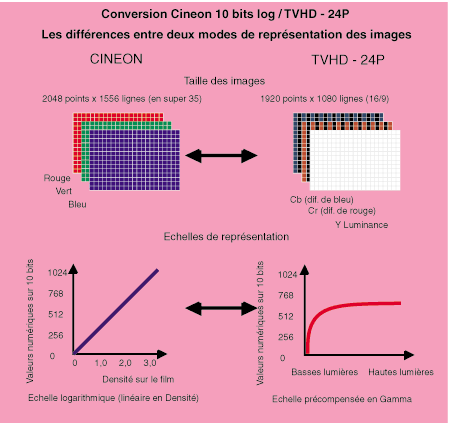
Le format Cineon 10 bits log
Les travaux de Kodak pour la mise au point de ce format sont basés sur les constatations suivantes :
Il reste ensuite à placer les valeurs numériques sur la courbe du film, Kodak a publié plusieurs recommandations à ce sujet, en tenant compte des inévitables conversions. Il est cependant possible, et dans certains cas peut-être souhaitable, d'utiliser des valeurs différentes.
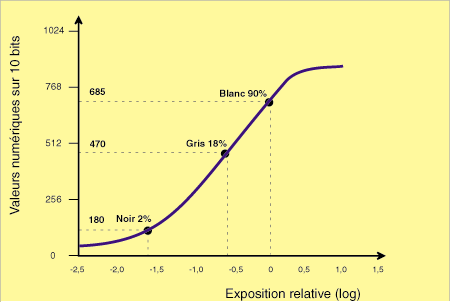
Valeurs de numérisation d'un négatif au format Cineon (source Kodak)
Le passage d'un format à l'autre ne se fait pas sans des distorsions qui sont essentiellement des erreurs d'arrondi. Un trop grand nombre de conversions de l'un à l'autre format a des conséquences visibles sur la qualité de l'image.
| La visualisation des images |
|
L'étalonnage
étant basé sur un contrôle visuel, les conditions d'observation
sont primordiales. En 35 mm le travail est validé par la projection
d'une copie de travail et réajusté si nécessaire.
En numérique, il n'est pas réaliste de passer par l'imageur
et le tirage d'une copie pour contrôler la fiabilité de la
chaîne. La solution la plus simple consiste à travailler avec
un moniteur Haute Définition qui soit parfaitement calibré.
Il faut cependant savoir qu'un moniteur n'a pas la même réponse
qu'une projection 35 mm et que la perception visuelle est différente
selon qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand écran.
En effet, sur un
petit écran l'œil aura tendance à évaluer
l'image d'une manière globale, alors qu'en projection l'œil
pourra suivre le visage d'un personnage. Pour ce rapprocher des conditions
optimales, il est possible d'équiper une salle avec un projecteur
numérique qui résoudra le problème de perception lié
à la taille de l'image. Aujourd'hui, la réponse d'un projecteur
numérique reste différente de celle d'un tube cathodique
et bien sûr d'une projection film !
D'autre part, pour
conserver l'affichage temps réel, il sera nécessaire de visualiser
en 8 bits seulement, l'image qui est, à l'origine, en 10 bits. La
calibration de l'ensemble de la chaîne, seule garante d'un travail
cohérent, sera un compromis difficile à trouver.
| Les outils logiciels |
|
| Parlons un peu d'argent |
|
Ce premier tour
d'horizon sur l'étalonnage numérique ne serait pas complet
sans quelques considérations économiques. Toujours dans le
cas d'un film tourné et projeté en 35 mm, l'investissement
global pour : le scanner, le correcteur colorimétrique, le super
calculateur, l'imageur et le magnétoscope Haute Définition,
représente à peu près 15 MF. La prestation équivalente
en photochimique, qui comprend aussi le développement des négatifs,
tirage et étalonnage des inter et une copie de travail, est actuellement
facturée environ 450 KF pour un film de 90 mn.
La question qui
se pose est de savoir quel surcoût est acceptable pour un étalonnage
numérique. Le temps supplémentaire de post-production est
aussi à prendre en compte, un étalonnage photochimique dure
environ deux semaines. Si on veut exploiter les possibilités du
numérique, il faut plus de temps, sans compter les opérations
de numérisation (scan) et imageur. La rentabilité sera difficile
à trouver, même si la plupart des équipements sont
utilisables pour d'autres prestations : transferts, effets spéciaux.
..
| L'étalonnage numérique dans le contexte de l'évolution des technologies |
|
Les principales difficultés qui viennent d'être évoquées sont principalement liées aux mélanges des technologies photochimiques et numériques. Dans la perspective "futuriste" d'un tournage et d'une diffusion (projection) entièrement numérique, l'étalonnage numérique s'insère avec la même facilité et la même logique que l'étalonnage photochimique dans les laboratoires traditionnels. Reste à savoir si cette vision futuriste deviendra une réalité sur une durée qui soit compatible avec l'amortissement des équipements.
Chaîne d'étalonnage numérique
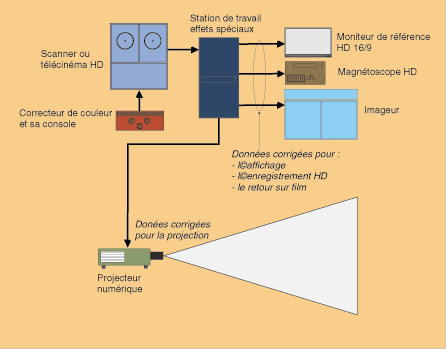
| Rédaction
et illustration : Matthieu Sintas
(msintas@cst.fr) |