| Dossier Technique N°21 | Novembre 1999 | ||
Nous vous proposons
pour ce dossier de revoir brièvement les étapes de fabrication
d'un film couleur puis d'aborder les problèmes de colorimétrie
comme nous l'avons fait dans notre dossier concernant l'étalonnage
numérique.
| 1. Rappels: |
|
1.1 Le film en noir et blanc
Pour démarrer
sur les mêmes bases pour tous nos lecteurs nous rappellerons brièvement
les principes de la photo argentique. D'une manière simplifiée,
on peut dire que les rayons lumineux renvoyés par un sujet et concentrés
par le passage à travers plusieurs lentilles (l'objectif photographique)
viennent frapper le film (pellicule sensible formée d'une base de
plastique - Triacetate/ Polyester - sur laquelle est étalée
une couche de gélatine contenant du bromure d'argent) à l'intérieur
d'une chambre noire.
Sous l'impact de
ces rayons, la structure des cristaux de bromure d'argent est altérée
Il se forme ainsi une image latente, c'est à dire une image qui
existe virtuellement telle quelle, mais que l'on ne voit pas encore et
que l'on ne peut utiliser telle quelle sous peine de la voir disparaître
à la lumière.
C'est à ce stade qu'interviennent les processus chimiques :
C'est à
partir de l'image négative que l'on obtient le positif (la photographie)
par tirage
On peut aussi traiter
le film selon un principe d'inversion et obtenir ainsi directement des
images positives transparentes (la diapositive).
1.2 La reproduction des couleurs et la synthèse soustractive
Nous avons vu dans les dossiers techniques précédents sur la notion de colorimétrie que toutes couleurs étaient obtenues à partir de trois couleurs primaires : le bleu, le vert et le rouge. C'est le principe de la trichromie que l'on retrouve dans la constitution de notre film couleur. Mais si certains systèmes reproduisant les couleurs, telle la télévision, sont basés sur le principe de l'addition en proportions variables de lumière rouge, verte et bleue. Les procédés photographique usuels sont basés au contraire sur la soustraction à de la lumière blanche d'une partie de ses constituants, le reste formant le rayonnement recherché. Pour supprimer une partie de la lumière blanche, on utilise des filtres. Les parties supprimées et non supprimées sont complémentaires.
A partir du cercle des couleurs, nous noterons les relations suivantes :
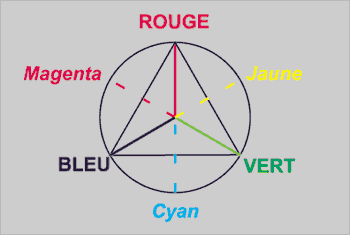 |
|
|
La manière dont les couleurs primaires rouge, vert et bleu sont notées et leurs couleurs complémentaires, jaune, cyan et magenta sont placées sur ce cercle permet les combinaisons suivantes :
On pourra grâce
à des filtres retirer une ou deux composantes à la lumière
utilisée pour le tournage et obtenir, par exemple, des effets Bleus
(en retirant le Jaune) ou Cyan en retirant la composante rouge ou bien
d'autres effets encore, à vous de jouer avec l'image ci dessus.
1.3 Notion de filtres
Un filtre est fait de verre teinté, de feuille de gélatine colorée, de verres recouverts de mince dépôt métallique évaporé sous vide (filtre interférentiel), d'empilement de verres séparés par des couches spéciales ou de combinaisons des constituants précédents. Ils sont de différents types, on distinguera :
Sur la même
base que le cercle des couleurs précédemment mentionné,
l'association des filtres jaune, magenta et cyan de bonne saturation fait
apparaître les combinaisons de couleur illustrées sur la figure
" Cercles des couleurs ".
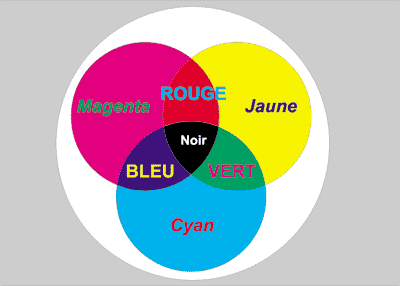 |
|
|
Avec des filtres jaune, magenta et cyan moins saturés, il est possible d'obtenir toutes les teintes et saturation de couleurs à tous les niveaux de luminosité depuis le fond blanc sur lequel on observe les filtres jusqu'au noir et il suffit pour cela de trois filtres. Pour rappel, notons que le procédé de restitution d'une couleur donnée au moyen de trois filtres jaune, magenta et cyan s'appelle " synthèse soustractive ".
C'est sur ce principe de soustraction de lumière par trois filtres successifs qu'est basé la restitution des couleurs par les films photographiques. Les films comportent trois couches ou ensembles de couches sensibles respectivement à la lumière bleue, verte et rouge. Ces sensibilités différenciées permettent, au moment de la prise de vue, l'analyse en rouge, vert et bleu de la lumière formant chaque point de l'image. Le film enregistre le résultat de cette analyse sous formes de trois images latentes. Après le développement, pendant lequel se forment les colorants jaunes magenta et cyan en quantités dépendant de l'exposition, les couches se comportent comme trois filtres localement colorés de façon que leur superposition examinée en transparence restitue l'image en couleur du sujet initial.
Suivant le type
de film utilisé et son traitement, l'image est " négative
", c'est à dire complémentaire de celle du sujet, ou " positive
". Dans les deux cas, l'analyse se fait en rouge, vert et bleu, et la restitution
avec des colorants cyan, magenta et jaune.
| 2. Fabrication d'un film |
|
Le film comporte trois éléments essentiels: Un support, Une couche d'émulsion photosensible, des couches annexes.
2.1 Support
Le support est destiné à porter l'émulsion ; il doit posséder des caractéristiques physiques très spécifiques. On utilise deux types de support pour les produits cinématographiques : Le Triacétate et le (polyester).
Les supports
de film photographiques sont recouverts lors de leur fabrication d'une
fine couche appelée " substratum " destinée à permettre
l'adhérence de l'émulsion sur le support. Cette couche est
constituée de gélatine et nitro-cellulose.
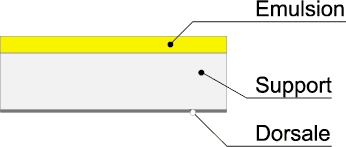 |
|
|
La couche anti-halo ou "jet-back" mise également pendant la fabrication du support sur la plupart des films ciné couleur a pour rôle à la fois d'absorber les réflexions parasites et de jouer le rôle de dorsale antistatique. Cette couche est éliminée lors du traitement.
2.2 Emulsion
L'émulsion constitue l'élément actif du film photographique. Seule couche sensible à la lumière, elle est le siège de la formation des images. De multiples constituants entrent dans sa composition dont les principaux sont :
A cela, s'ajoutent
des composés divers, par exemple :
La sensibilité, Le contraste, La granularité
Par exemple :
Emulsion à
gros grains -----> sensibilité forte, contraste faible.
Emulsion à
grains de taille variées -----> contraste moyen ou faible/ sensibilité
moyenne
Emulsion à
grains fins ---> sensibilité faible et contraste élevé
2.3 Emulsionnage
L'émulsionnage appelé souvent couchage est la troisième étape de la fabrication du film, qui comprend :
2.4 Finition
Cette étape est divisée en trois secteurs principaux : La coupe, La perforation/ Le montage, et le conditionnement
| 3. Structure d'image |
|
La qualité
de l'image dépend de deux paramètres importants :
La granulation
La netteté
3.1 La granulation
Il s'agit d'une impression subjective de non-uniformité d'une surface exposée et développée. Elle est produite par le regroupement aléatoire des colorants dans l'image du film et dépend du rapport d'agrandissement de l'image et de la distance d'examen.
Afin de comparer différents films, il est nécessaire d'avoir une mesure objective du grain : c'est la granularité.
La granularité est une mesure objective qui permet d'établir une corrélation avec la sensation visuelle de granulation. Elle est effectuée sur un échantillon exposé et développé, par un micro-densitomètre à partir d'une tâche d'exploration circulaire de 48 *m de diamètre avec un rapport d'agrandissement de 12. Elle fait appel à une loi statistique de répartition au hasard, et s'exprime " en écart quadratique moyen " - RMS - (Root mean square). Une granularité inférieure à 5 sera ultra fine et extrêmement fine pour des valeurs comprises entre 6 et 10, très fine entre 11 et 15 et finalement fine entre 16 et 20.
Il est important de noter comme repère, qu'un écart de 6% entre deux valeurs de granularité correspond " à une différence juste perceptible " de l'impression visuelle de la granulation.
3.2 La Netteté
C'est une composante de la définition, qui est une impression subjective en rapport avec la perception des bords et des contours de chacun des éléments de l'image observée. Il n'y pas de valeur objective directe permettant de mesurer la netteté ou la définition. Par contre on peut faire des analyses quantitatives précises de la perception de la netteté par :
Le pouvoir résolvant
est la mesure de l'aptitude d'une émulsion à enregistrer
le maximum de détails contenus dans une image. Celui ci est mesuré
grâce à des mires et s'exprime en nombre de lignes discernables
au millimètre (1 paires de lignes par mm = 1 trait noir + 1 trait
blanc).
La fonction de transfert
de modulation met en évidence la capacité d'un film à
reproduire les fréquences spatiales complexes d'une mire sinusoïdale.
Elle permet donc d'analyser la réponse d'un film au différentes
variations de contraste.
| 4. Sensitométrie |
|
4.1 Définition
Nous ne développerons
pas ce paragraphe puisqu'un ouvrage sur la sensitométrie sera prochainement
publié par la CST. En voici cependant la définition :
"La sensitométrie
est dans son sens le plus large, la science qui étudie les effets
de la lumination et du développement sur les émulsions photographiques."
4.2 Courbe
La caractéristique sensitométrique représentant la variation de densité (logarithme de l'opacité) de la couche photosensible en fonction de la lumination en lux. seconde (produit de l'éclairement reçu par la couche sensible par la durée de l'exposition) se présente sous la forme suivante pour une émulsion noir et blanc .
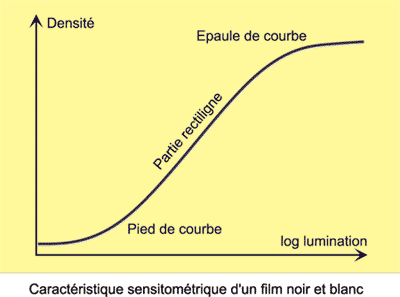 |
4.3 Les paramètres de la courbe
Trois parties de la courbe intéressent particulièrement les directeurs de la photographie. D'abord le pied de la courbe, quand peu de lumière impressionne le film et que la pente augmente progressivement avec l'exposition. En effet plus la pente de la courbe d'un film est importante, plus ce film changera rapidement de densité - et donc plus il virera facilement au noir. Au contraire, plus l'augmentation de la pente du pied est progressive, plus le film sera capable de faire ressortir des détails dans les ombres - en conservant des différences subtiles entre les niveaux de noir.
Ensuite dans la
partie rectiligne de la courbe, la pente de cette partie linéaire,
ou facteur de contraste  de la plupart des films
reste constante - la densité augmentant dans une proportion logarithmique
par rapport à l'exposition. Autrement dit, chaque augmentation de
l'exposition d'une valeur d'un diaphragme double la quantité de
lumière qui arrive sur le film, provoquant ainsi une augmentation
constante de la densité sur le négatif. Les informations
les plus importantes sont enregistrées sur la partie rectiligne
de la courbe.
de la plupart des films
reste constante - la densité augmentant dans une proportion logarithmique
par rapport à l'exposition. Autrement dit, chaque augmentation de
l'exposition d'une valeur d'un diaphragme double la quantité de
lumière qui arrive sur le film, provoquant ainsi une augmentation
constante de la densité sur le négatif. Les informations
les plus importantes sont enregistrées sur la partie rectiligne
de la courbe.
Au niveau de l'épaule, la pente de la courbe diminue - Les augmentations supplémentaires de l'exposition ne provoquant qu'un accroissement de la densité faible, puis nul.
Avec les films actuels à grande latitude d'exposition et des négatifs normalement exposés, peu d'informations importantes d'une image seront exposées sur l'épaule. Au contraire, la plupart des zones blanches de la scène seront enregistrées sur la partie rectiligne de la courbe, ce qui explique pourquoi les films actuels sont si performants pour l'enregistrement des hautes lumières.
Les films noir et
blanc n'ont qu'une seule courbe caractéristique. Les films couleur
au contraire en comptent naturellement au moins trois - une courbe par
enregistrement de couleur.
| 5. Le film Couleur |
|
5.1 Constitution du film
Comme nous l'avons vu lors de nos rappels, le film couleur est composé de plusieurs couches, on aura la structure suivante pour un film négatif :
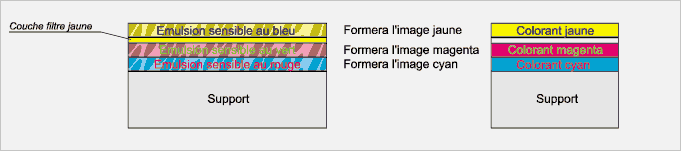 |
Coupe d'un film couleur
La sensibilité naturelle des cristaux d'halogénure d'argent est dans le bleu, il paraîtra normal d'observer que cette sensibilité subsistera, même pour des cristaux sensibilisés au vert et au rouge. La lumière bleue, passant au travers des couches vertes et rouge, y produit donc un effet indésirable, nuisible à une bonne reproduction des couleurs. Cette effet sera minimisé par l'emploi d'un filtre jaune qui, placé sous la couche sensible au bleu, absorbera cette radiation avant qu'elle n'atteigne les couches inférieures, tout en permettant aux radiations verte et rouge d'atteindre leur récepteur.
En plus de l'amélioration de la reproduction des couleurs, cette séparation nette entre bleu et vert permet des applications dans le domaine des effets spéciaux, avec en particulier l'utilisation des écrans bleus et celle des caches/contrecaches. Cette couche "filtre jaune" est ensuite décolorée au cours du traitement.
Il y a encore d'autres substances actives incorporées au film négatif. Par exemple, des anti-voiles (voir 2.2) qui permettent d'éviter une augmentation de la densité minimale aussi bien dans le film vierge qu'au cours du traitement.
Nous pouvons aussi citer les colorants absorbants, solubles dans l'eau qui, en contrôlant la dispersion lumineuse, née des réflexions, inévitables, augmentent la définition et la résolution de l'image.
Chaque couche de sélection contient des sels photosensibles de bromure d'argent et un coupleur qui formera un colorant lors du développement chromogène.
Chaque couche comporte au moins deux sous-couches (une rapide + une lente), la couche magenta en comporte trois (une rapide, une lente et une médium).
5.2 Le développement/ Les coupleurs
Au cours du traitement, les informations contenues dans les cristaux d'halogénure se transforment en une image de colorant. Ainsi, du colorant jaune est formé dans la couche sensible au bleu, du magenta dans celle sensible au vert et du cyan dans la couche sensible au rouge.
On peut encore améliorer la structure de l'image obtenue, en particulier, le grain, la définition et la saturation des couleurs en faisant appel à des coupleurs particuliers :
Un coupleur
DIAR est une molécule qui comporte trois groupements :
Un coupleur DIR fonctionne de la même façon, à ceci près que la libération d'inhibiteur se fait sans délai, au fur et à mesure de la formation du colorant. Son rayon d'action est plus restreint.
Ce processus a plusieurs conséquences :
La définition est également augmentée par un meilleur contrôle du développement autour des petits détails :
5.3 L'utilisation des coupleurs pour le développement du négatif
Une autre technologie appelée " masque " est utilisée pour améliorer le rendu des couleurs. Elle consiste à compenser les absorptions indésirables des colorants formant l'image. Par exemple, les colorants magenta ne sont pas parfaits. Ils absorbent non seulement le vert, mais également une petite partie de la lumière bleue. Pour corriger par exemple l'absorption indésirable du colorant magenta en lumière bleue, on fait appel à un coupleur coloré en jaune qui disparaîtra proportionnellement à la quantité de colorant magenta formé. Au fur et à mesure de la formation du colorant magenta et donc du colorant bleue indésirable, le coupleur coloré en jaune disparaît par réaction avec le révélateur oxydé. La couleur jaune est remplacée par le magenta. Ces deux effets - production du magenta et disparition du Jaune - ont pour conséquence que la densité bleue ne varie pas en fonction de la densité verte.
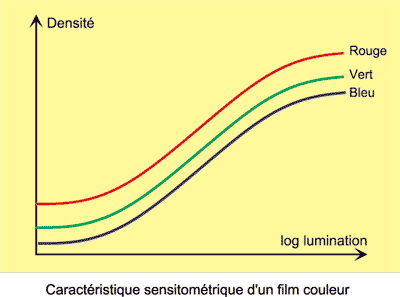 |
Bien entendu, la densité bleue totale est plus élevée avec le masque que sans. Cet inconvénient est compensé - en tireuse ou sur télécinéma- par l'avantage d'obtenir des couleurs pures, quelle que soit leur densité dans les ombres ou les hautes lumières.
La même technique est utilisée avec le colorant cyan formé proportionnellement à la lumière rouge reçue.
Les coupleurs sont colorés en Magenta de façon à corriger l'absorption indésirable en vert du colorant Cyan.
C'est dons l'ensemble des coupleurs colorés en jaune et magenta qui donne au négatif traité sa couleur orangé caractéristique dans les parties non exposées de la pellicule.
La pellicule argentique
pour le cinéma est un produit extrêmement élaboré.
Sa structure aléatoire comprend un nombre non négligeable
(plusieurs millions)de cristaux au millimètre carré, qui
permettent un rendu excellent de l'image. Le film a donc de beaux jours
devant lui, tout du moins tant que les CCD n'auront pas atteint la qualité
de la structure du film (soit plusieurs centaines de millions de cellules
par CCD).
| Rédaction
: Françoise Duclos (Kodak)
avec l'aide des supports de cours du CEFOM Kodak du CTP Ciné Chalon s/Saône et de Michel Baptiste (CST). |