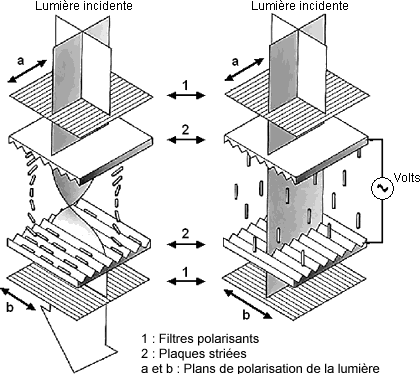
Figure 1 : la modulation de la lumière par les cristaux liquides
| Dossier Technique N°3 | Janvier 1998 | ||
Alors que les premiers écrans plats de télévision font leur apparition dans les magasins, il est nécessaire de faire le point sur les enjeux techniques et les raisons d'être de ce marché naissant. Pourquoi faut-il fabriquer des écrans plats ? Principalement, deux types d'applications sont envisagés :
Rappelons brièvement le cahier des charges. Les nouvelles technologies qui vont s'imposer doivent offrir une qualité équivalente à l'actuel tube cathodique, car le public n'acceptera pas un retour en arrière sur les points suivants :
Dans la présentation de quelques technologies possibles,
nous commencerons par celles qui sont déjà commercialisées.
| Les écrans à
cristaux liquides LCD
(Liquid Crystal Displays) |
|
Les cristaux liquides sont des matières organiques amorphes, qui ont la propriété de modifier la propagation de la lumière, plus exactement sa polarisation, si on leur applique un champ électrique. Leurs molécules, de forme allongées, s'ordonnent naturellement de manière parallèle les unes aux autres. Déposées sur une plaque gravée de sillons, les molécules vont s'aligner dans les sillons. Le principe de l'écran LCD consiste à placer des cristaux liquides en sandwich entre deux plaques gravées et orientées à 90°. Les molécules, au repos, vont passer progressivement d'une orientation à l'autre (voir la figure 1). L'écran est rétro-éclairé avec une lumière polarisée parallèlement aux sillons de la première plaque, sa polarisation est guidée par les molécules et après une rotation de 90° elle passe par un deuxième filtre polarisant. Sous l'effet d'une tension de commande, les molécules vont progressivement s'orienter dans le sens du champ électrique et la lumière sera bloquée par le deuxième polariseur. Chaque pixel de l'image est constitué d'une cellule de ce type devant laquelle est placé un filtre rouge, vert, ou bleu.
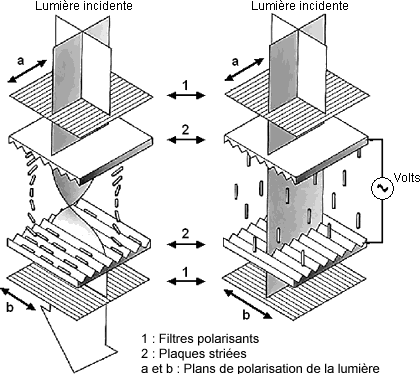
Figure 1 : la modulation de la lumière par les cristaux liquides
La principale difficulté réside dans le système de commande des pixels. Le système à matrice passive utilisé dans les premiers ordinateurs portables est beaucoup trop lent pour convenir au flux d'image vidéo. Il faut donc employer des matrices dites actives, constituées de transistors en couche mince TFT (Thin Film Transistor). Ces matrices assurent une commutation rapide mais sont très difficiles à réaliser. Plus la taille de l'écran augmente, plus grand est le nombre de transistors et importante l'augmentation des risques de défaut. Un écran de 20'' semble être une limite technologique au-delà de laquelle peu de constructeurs se sont risqués. L'angle de vision naturellement réduit de l'écran LCD est une autre contrainte pour son adaptation au marché de la télévision. Cette description reste sommaire, car il existe de nombreuses variantes de structure et de type de molécule pour la réalisation des panneaux LCD. L'angle de vision réduit s'améliore progressivement par la mise en oeuvre de diverses solutions.
La technologie LCD connaît un beau succès
avec les ordinateurs portables et les vidéoprojecteurs mais reste
coûteuse et inadaptée aux écrans de grandes dimensions.
| Les écrans à plasma |
|
L'écran à plasma PDP (Plasma Display Panel), dont la commercialisation débute tout juste en France, représente l'une des solutions possibles pour concevoir de grands écrans plats de qualité. Le principe général consiste à amorcer et entretenir une décharge électrique dans une cellule contenant un gaz sous faible pression. Comme dans un tube fluorescent, la décharge émet un rayonnement ultraviolet qui sera transformé en lumière visible rouge, verte ou bleue par des luminophores. Cette cellule élémentaire représente un pixel, et sera dupliquée autant de fois que la taille et la résolution de l'écran l'exige. La structure de l'écran consiste en deux plaques de verre, sur l'une desquelles on grave les cellules. Les électrodes sont déposées par sérigraphie. Deux variantes utilisent ce principe : la technologie DC à courant continu étudiée par la NHK et Matsushita et la technologie AC à courant alternatif de Fujitsu. Les différences principales entre ces deux techniques concernent le mode d'entretien de la décharge dans les capsules de gaz.
Ce point est très important, car il influe sur les performances des écrans, notamment la luminosité, la longévité et la consommation électrique. Dans l'état actuel des travaux, aucune des deux solutions n'est satisfaisante sur tous les points. La Figure 2, montre la structure d'un écran de type AC.
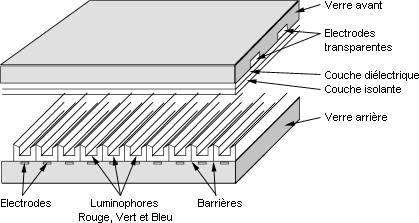
Figure 2
Toute la difficulté réside dans le contrôle
précis du niveau de luminance de chaque pixel, tout au long de la
durée de vie de l'écran. En effet, une décharge électrique
dans un gaz est un phénomène instable qu'il faut ici maîtriser
avec précision pour reproduire avec cohérence l'ensemble
des valeurs d'une image.
| Le plasmatron PALC
(Plasma Addressed Liquid Crystal) |
|
La technologie plasmatron, développée conjointement par Sony et Tektronix, présente un mélange des principes LCD et Plasma. Puisque le problème des grands panneaux de LCD est la matrice active (TFT), celle-ci est remplacée par une matrice active à plasma. La figure 3, montre la structure d'un écran plasmatron. Le principe consiste à utiliser une décharge électrique dans un gaz pour qu'il passe à l'état de plasma ionisé, donc conducteur. La cellule gazeuse va se comporter comme un interrupteur, et non plus comme une source de lumière, pour remplacer les transistors en couche mince des écrans LCD traditionnels.
Malgré les difficultés liées aux deux technologies employées (voir plus haut) le Plasmatron semble donner de bon résultats.

Figure 3 : Structure d'un écran plasmatron
| Les tubes cathodiques plats |
|
Plusieurs constructeurs travaillent à la réalisation d'un écran cathodique plat. Matsushita a commercialisé au Japon en 1994 un modèle de 14" nommé " Flat Vision ". Le laboratoire de recherche de Philips à Eindhoven, a présenté un projet nommé CRP (Cathodic Ray Panel), à la conférence de la " Society for Information Display " à Boston. Le CRP est basé sur le transport d'électrons par petits sauts dans une structure isolante. Le principe est simple : si des électrons émis par une cathode chauffée sont injectés dans un tube de verre dans des conditions bien précises, ils vont s'écouler à l'autre extrémité du tube (voir figure 4), après avoir cheminé à proximité de la paroi par petits sauts. La tension de transport, pour laquelle chaque électron qui heurte la paroi en génère un autre (figure 4a) dépend des paramètres physiques du tube, notamment de son diamètre et de sa longueur. Si la tension est inférieure à la tension de transport, les électrons tendent à rebondir entre les parois (figure 4b). Dans ce principe de transport, les électrons émis par un fil (cathode) situé en bas de l'écran vont se déplacer par petits sauts sur la plaque du fond avant d'être attirés vers des luminophores traditionnels.

Figure 4 : Principe de transport des électrons par petits sauts
La figure 5 montre l'une des structures possibles présentée par Philips.
Si le principe est simple, sa mise en oeuvre dans un écran l'est beaucoup moins. Toute la difficulté réside dans l'adressage des électrons vers la plaque avant. Le contrôle de l'énergie avec laquelle les électrons vont heurter les luminophores, garant d'une bonne uniformité de luminance, est aussi un problème délicat à résoudre. Il s'agit d'une recherche intéressante qui reprend les éléments connus dans les CRT, cathode, luminophores, etc... Cette " cure d'amaigrissement " fera peut-être renaître le bon vieux tube cathodique, transformé en CRP, pour les 50 années à venir !
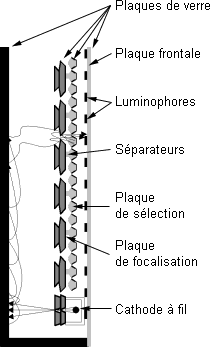
Figure 5 : Structure d'un CRP
| Les panneaux de diodes |
|
Les diodes électroluminescentes, LED (Light Emitting
Diodes), sont utilisées pour constituer des panneaux de grandes
dimensions lors de spectacles ou d'événements sportifs. Cette
technologie ne semblait pas adaptée aux écrans de télévision.
L'adressage de diodes est compliqué, la consommation électrique
élevée, les diodes constituent des pixels trop gros pour
un usage domestique et il n'existait pas de diodes qui émettent
de la lumière bleue ; ce n'est que très récemment
que l'on est arrivé à produire des diodes bleues et elles
ont déjà été intégrées dans un
écran montré au NAB 97. Il est possible que cette nouvelle
donne relance les recherches dans le domaine des écrans de télévision.
Rédaction Matthieu Sintas
Bibliographie :
a new approach to the granddaddy of displays, Gene Heftmann (Electronic Design, 7 Juillet 1997) réunion du Département Imagerie Electronique, Janvier 1997 François Luxereau (Image Expert, Février/Mars 1996) René Bouillot (Vidéo Broadcast, Octobre 1996) René Bouillot (Vidéo Broadcast, Décembre 1995) la filière "Plasma", J.P. Landragin (Le Haut Parleur n°1853) J.P. Landragin (Le Haut Parleur n°1852) Sharp, 1991 |
Dossier réalisé avec la collaboration de François Luxereau et Bernard Tichit.