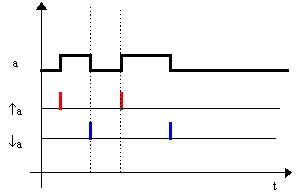|
|
|
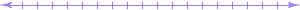
A.
GRAFCET
1.
Cahier des charges
2.
Le GRAFCET: outil de description d’un cahier des charges
3.
Eléments du GRAFCET
4.
Règles du GRAFCET
5.
Structures de base:
6.
Actions associées
7.
Réceptivités particulières
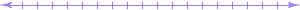
GRAFCET
Cahier
des charges
Le cahier des
charges est le descriptif fourni par l’utilisateur au concepteur de l’automatisme
pour lui indiquer les différents modes de marches et les sécurités
que devra posséder l’automatisme.
Le cahier
des charges décrit le comportement de la partie opérative
par rapport à la partie commande.
L’automaticien
doit se référer au cahier des charges pour réaliser
l’automatisme, il fait force de loi.
Le GRAFCET,
les organigrammes, les logigrammes, les chronogrammes sont des outils utilisés
pour décrire le comportement d'un système automatisé.
La description
du fonctionnement d’un système automatisé ne doit pas être
source de malentendus (mots ambigus, mots techniques..),le GRAFCET peut
être utilisé pour décrire le cahier des charges.
Le
GRAFCET: outil de description d’un cahier des charges
Définition
Le GRAFCET
est un diagramme fonctionnel dont le but est de décrire graphiquement
les différents comportements d’un automatisme séquentiel.
Exemple: Poinçonneuse
| CAHIER
DES CHARGES(partiel)
A l’état
initial le poinçon est en position haute, l’opérateur installe
la pièce, une action sur marche fait descendre le poinçon
jusqu’à la position basse puis il retourne en position initiale. |
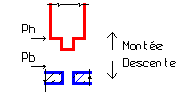 |
GRAFCET de la poinçonneuse

-A chaque
comportement du système on associe une étape du GRAFCET
-Des actions
qui caractérisent ce comportement sont associées aux étapes
- Pour que
le système évolue d’une étape à la suivante
les conditions de transition doivent être remplies on dit qu’il y
a franchissement de la transition.
- La condition de passage est appelée réceptivité.
Synthèse presse
d'assemblage
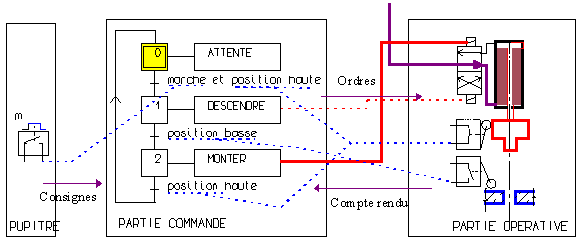
Les ordres
correspondent aux actions du GRAFCET
Les réceptivités
sont constituées des comptes rendus et des consignes.
Animation
presse d'assemblage
Eléments
du GRAFCET
-ETAPE:
Une étape
correspond à un comportement stable du système. les étapes
sont numérotées dans l’ordre croissant. A chaque étape
peuvent correspondre une ou plusieurs actions. Une étape est soit
active soit inactive.
-ETAPE INITIALE:
La ou les étapes
initiales caractérisent l’état du système au début
du fonctionnement.
-TRANSITION:
Les transitions
indiquent les possibilités d’évolution du cycle, à
chaque transition est associée une réceptivité.
-RECEPTIVITE:
La réceptivité
est la condition logique qui permet l’évolution si la réceptivité
est vraie (=1) le cycle peut évoluer. Les réceptivités
sont des comptes-rendus en provenance de la partie opérative ou
des consignes en provenance du pupitre.
-LIAISONS ORIENTEES:
Un GRAFCET
se lit de haut en bas, dans un autre sens il est nécessaire d’indiquer
le sens par une flèche.
-ACTIONS:
Les actions
sont réalisées lorsque l'étape associée à
l'action est active. Il est possible de définir des actions inconditionnelles,
ou conditionnelles, temporisées, à niveaux, mémorisées,
impulsionnelles.
Règles
du GRAFCET
Règle 1
L'initialisation
précise les étapes actives au début du fonctionnement.
Elles sont activées inconditionnellement et repérées
sur le GRAFCET en doublant les cotés des symboles correspondants.
Règle 2
Une transition
est soit validée soit non validée. Elle est validée
lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes
sont actives. Elle ne peut être franchie que :
- Lorsqu'elle
est validée,
- ET que
la réceptivité associée à la transition est
vraie.
Elle est
alors obligatoirement franchie.
Règle 3
Le franchissement
d'une transition entraîne l'activation de toutes les étapes
immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les
étapes immédiatement précédentes.
Règle 4
Plusieurs transitions
simultanément franchissables sont simultanément franchies.
Règle 5
Si au cours
du fonctionnement, une même étape doit être désactivée
et activée simultanément, elle reste active.
Nota
La durée
de franchissement d'une transition ne peut jamais être rigoureusement
nulle, même si elle peut être rendue aussi petite que l'on
veut. Il en est de même pour la durée d'activation d'une étape.
Structures
de base:
séquence unique
(structure linéaire)
| Dans
un cycle à séquence unique les étapes et les transitions
se succèdent de manière linéaire.
|
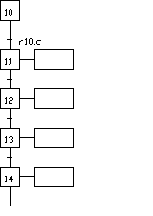 |
Sélection de séquence
Un GRAFCET
est dit à sélection de séquence lorsque à partir
d’une étape plusieurs évolutions sont possibles. On distingue:
- Séquences exclusives:
- saut d’étapes:
- reprise d’étapes:
| Séquences
exclusives |
Saut
d’étapes: |
Reprise
d’étapes |
| une
sélection de séquence est dite exclusive lorsque les réceptivités
associées aux transitions ne peuvent pas être vraies simultanément. |
le
saut d’étapes est une sélection de séquence permettant
de sauter plusieurs étapes en fonction des conditions d’évolution. |
la
reprise d’étapes au contraire permet de recommencer plusieurs fois
si nécessaire une même séquence. |
|
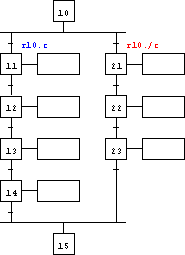
|
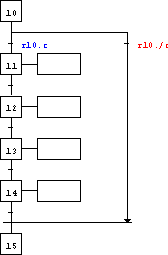
|
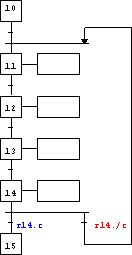
|
| En
fonction des réceptivités l'étape 13 ou 21 va être
activée. Les 2 réceptivités doivent être exclusives. |
Si
la réceptivité "r10./c" est vraie alors les étapes
11 à 14 sont sautées. |
Si
la réceptivité "r14./c" est vraie alors la séquence
d'étapes 11 à 14 est de nouveau exécutée. |
GRAFCET à sélection
de séquence - exemple: contrôle de pièces
parallélisme structural
- séquences simultanées
| Ce
type de cycle est surtout utilisé sur des machines du type transfert
ou des machines comportants plusieurs sous machines travaillant de manière
indépendante.
Dans un
cycle à séquences simultanées, les séquences
débutent en même temps, finissent en même temps, mais
les étapes de chaque branche évoluent de façon indépendante
..
|
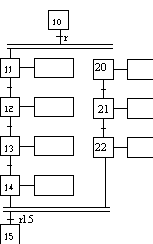 |
Exemple: tri de caisse
Actions
associées
Les actions
sont précisées dans un cadre lié à l’étape,
de manière générale, l’action n’est vraie que si l’étape
est active. La norme européenne CEI précise la nature de
l’action par une lettre précisant la nature de l’action.
Actions à niveaux
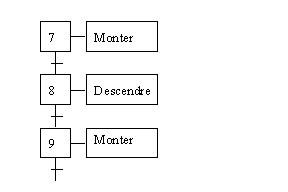 |
Forme
générale d’une action
dans une
action à niveaux, la sortie n’est vraie que si l’étape est
active
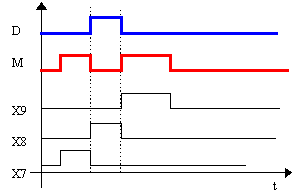
|
Actions mémorisées
| Description
usuelle |
Description
norme europeenne CEI |
Dans
une action mémorisée on distingue la mise à 1 et la
mise à 0 de l’action.
La norme
CEI précise la mise à 1 et la mise à 0 par les lettres
S (set) et R (reset). |
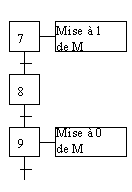 |
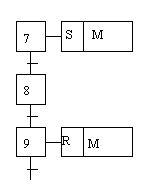
S = Set
: mise à 1
R = Reset
: remise à zéro |
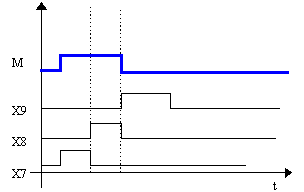 |
Actions conditionnelles
Prise en compte du temps
La prise en
compte du temps dans un grafcet peut être traité soit au niveau
de la description des actions ou dans l’écriture des réceptivités.
On distingue
2 types d’actions, les actions retardées et les actions à
durée limitée.
Actions à durée
limitée
| Description
usuelle |
Description
norme europeenne CEI |
L’action
M de dure que 3 s à partir du début de l’étape X7. |
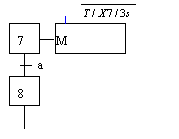 L’action
est exécutée tant que la temporisation n’est pas terminée. L’action
est exécutée tant que la temporisation n’est pas terminée. |
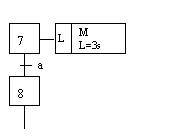 |
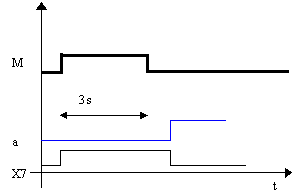 |
Actions retardée
| Description
usuelle |
Description
norme europeenne CEI |
L’action
ne M débute que 3 s à partir du début de l’étape
X7. |
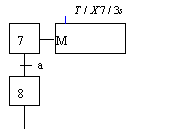 L’action est exécutée tant si temporisation est terminée.
L’action est exécutée tant si temporisation est terminée. |
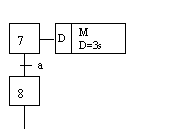 |
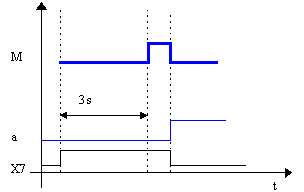 |
Réceptivités
particulières
Prise en compte du temps
L’autre manière
de prendre en compte le temps dans le grafcet est sa prise en compte dans
les réceptivités.
| Description
usuelle |
Description
norme europeenne CEI |
La
temporisation est lancée dès l’activation de l’étape
X7, elle n’est effective que au bout du temps T=3s,
La réceptivité
étant vraie, la transition est franchie. |
|
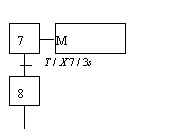 L’action est exécutée tant si temporisation est terminée.
L’action est exécutée tant si temporisation est terminée.
|
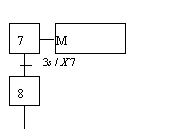
|
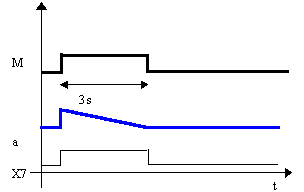 |
Description des temporisations
selon la norme CEI
Prise en compte des événements
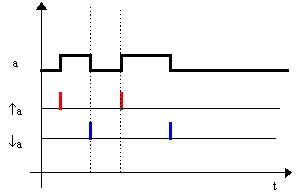
Front montant
On appelle
front montant de la variable binaire a, la variable, notée
a, qui prend la valeur 1 à l’instant du passage de 0 à
1 de la variable a.
Front descendant
On appelle
front descendant de la variable binaire a, la variable, notée
a, qui prend la valeur 1 à l’instant du passage de 1 à
0 de la variable a.
Exemple
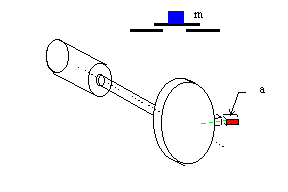
Un système
est constitué d’un moteur M et d’un bouton m (marche) et d’un capteur
a qui détecte la position angulaire du disque.
Cycle
Au début
du fonctionnement le disque est arrêté en position de référence
(a actionné). Une impulsion sur m provoque une rotation de 1 tour
complet du disque.
Remarque
: la succession des états non a puis a représente
la détection du front montant. |
Utilisation
de l’alternance des niveaux
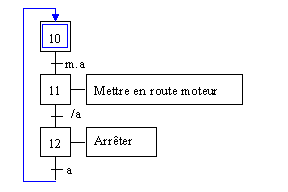
Utilisation
des fronts montants :
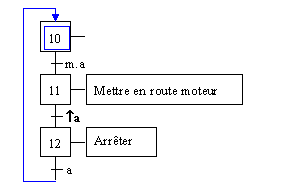
|
|