Propagation VHF
Propagation VHF
![]()
| C'est
la propagation VHF qui offre le plus d'aspects intéressants (à mes yeux)
au radioamateur tant elle est riche et diversifiée. Le nouveau
radioamateur qui ne connaît la plupart du temps que le trafic par le relais du
coin, ce qui revient, pour un être raffiné, à ne manger et boire que du
pain et de l'eau, n'utilise que la propagation à portée optique et c'est
très réducteur. Souhaitons que ce voyage dans la troposphère lui ouvre
de nouveaux horizons. |
|
|
Présentation : Nous allons passer en revue les principaux modes de propagation V/UHF exploités aujourd'hui ce qui nous conduira à examiner : 1 - la propagation troposphérique 2 - la tropo scatter (TS) 3 - la sporadique E (Es) 4 - La FAI 5 - le meteor scatter (MS) 6 - l'EME 7 - la transéquatoriale (TE) 8 - l'Ionoscatter. 9 - L'aurore boréale
|
|
| la
propagation en espace libre : |
|
|
C'est presque un mythe mais cela sert de base
de départ à tout calcul. Rappelons que notre objectif de radioamateur est
de délivrer suffisamment de puissance à l'entrée du récepteur de notre
correspondant pour que les informations que nous voulons véhiculer puissent
être démodulée. Nous allons quantifier les pertes que nos pourrions rencontrer sur un hypothétique trajet, exempt de tout obstacle susceptible d'absorber, réfracter, réfléchir ou diffuser l'énergie émise; ce pourrait être par exemple un trajet de développant dans le vide. |
|
|
Pour calculer ceci, nous allons considérer un
émetteur de puissance Pt, couplé à une antenne qui rayonne de manière
identique dans toutes les directions (l'aérien isotrope). A une distance d de l'émetteur, la puissance est distribuée uniformément sur une surface 4pd2 (surface de la sphère). La densité de puissance vaut la puissance divisée par la surface, soit en d'autres termes : Nota : Sur la figure à droite, l'antenne émettrice est une antenne à gain puisque seulement une partie de la sphère est illuminée. |
|
|
|
|
|
Intéressons nous maintenant à la
réception, de l'autre côté . La quantité d'énergie captée est
dépendante de l'antenne de réception et plus particulièrement d'un
critère appelé "surface de capture" notée Ar. Intuitivement et
expérimentalement vous mesurez bien que l'on reçoit mieux avec une antenne
yagi de 5 mètres de long qu'avec l'antenne scoubidou d'un pocket!
|
|
|
La Puissance reçue Pr
= s.Ar |
Pour l'aérien isotrope Ar vaut : |
|
Ce qui nous donne comme puissance reçue à
une distance "d" exprimée en mètres, à une longueur d'onde l
également exprimée en mètres : |
|
|
Cette expression n'est pas commode à
manipuler et on trouve plus fréquemment dans la littérature la formule
suivante : |
|
| Lp = 32,45 + 20 Log f + 20 Log d |
avec f en MHz d en km Lp, perte de parcours, en dB |
|
Bilan de liaison : |
|
|
Je sais que maintenant ce sont les ordinateurs
qui calculent tout cela mais j'ai conservé une âme d'artisan. Voyons
comment procéder : |
|
et nous serons capables de déterminer la puissance théoriquement reçue par l'entrée d'un récepteur situé à une distance "d" sur une fréquence "f" |
|
|
"t" pour transmit |
Pr = puissance reçue (dbm/dbw, dépend de
l'unité que vous avez adopté pour Pt) Pt = puissance en dbm ou dbW Lp = Atténuation de parcours entre antennes isotropiques en dB Gt = gain de l'antenne d'émission en dBi Gr = gain de l'antenne de réception en dBi Lt = perte dans la ligne tx vers antenne - dB Lr = perte dans la ligne ant vers rx - dB |
|
Attention aux unités lors des calculs, soyez
cohérents, utilisez soit des dbm soit des dbW mais toujours la même
untité pour un calcul donné. Un exemple maintenant : Soit à déterminer la puissance reçue par le récepteur d'une station distante de 100 km d'un émetteur délivrant une puissance de 10W. Les antennes utilisées ont un gain unitaire (soit 0dB), les pertes dans les lignes sont égales à 1 dB de chaque côté. Fréquence 144 MHz. |
|
|
|
|
Telle est la puissance théoriquement reçue
à l'entrée du récepteur en espace libre. Seulement entre la théorie et la pratique il y a souvent une différence notable et telle liaison, qui sur la papier ne pose pas problème, s'avère irréalisable alors que telle autre, impossible théoriquement, se concrétise par une belle QSL en couleur. Alors quid ? |
|
|
Il se trouve que nous ne sommes pas en espace
libre mais que nos signaux, en V/UHF transitent dans la troposphère et
qu'ils ne se comportent pas tout à fait comme des traits de crayon sur une
feuille blanche. La suite immédiatement... |
|
|
Atmosphère, atmosphère...
|
|
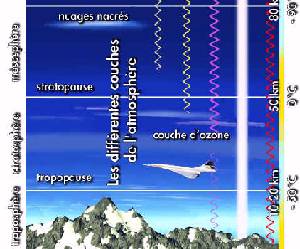
|
Puisque nous allons utiliser ses propriétés,
autant la connaître un peu non ? Et si cela vous pompe l'air (je suis en
verve aujourd'hui), passez au chapitre suivant. Nos signaux VHF vont utiliser une faible partie de l'atmosphère, en gros entre le sol et 5 km d'altitude pour la propagation troposphérique. Comme vous avez déjà pu le remarquer, il se produit dans l'atmosphère des phénomènes météorologiques qui vont du plus agréable (beau temps, ciel bleu, douce brise) au plus désagréable (ouragan, tornades, précipitations, gel, neige, bourrasques etc.). C'est d'ailleurs pourquoi cette partie s'appelle la troposphère, c'est la "partie changeante" (grec ou latin, je ne sais plus). |
| Dans la troposphère on trouve de l'air et ce gaz est affecté de quelques propriétés : | |
|
|
|
Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir
quelles sont les propriétés essentielles qui auront un impact sur notre
DDFM ou sur les locators contactés. Examinons cela : |
|
|
L'air a une distribution verticale
quasi-linéaire de la température et de la vapeur d'eau. En d'autre termes,
plus vous montez, moins il fait chaud, moins c'est humide. (Au fait vous
savez pourquoi il fait moins chaud ? C'est parce qu'il y a moins de
molécules, donc moins de collisions, donc moins de chaleur dégagée et
c'est le poids de la masse d'air qui fait la pression atmosphérique,
lumineux non ?). |
|
|
Il a une autre propriété intéressante,
c'est son indice de réfraction. Vous vous souvenez, nous avons vu quelques
exemples comme le bouchon de pêcheur à la ligne dont la partie immergée
semble incurvée; ceci est dû au fait que la lumière ne voyage pas à la
même vitesse dans les milieux transparents. Vous avez déjà remarqué certains phénomènes optiques dans l'atmosphère, citons : |
|
|
|
|
La majorité de ces phénomènes sont dus à
l'indice de réfraction de l'air qui n'est pas constant et décroît au fur
et à mesure que l'on s'élève. Nous venons de parler d'indice de
réfraction ce qui nous amène sur une première piste. Les signaux que nous
allons envoyer dans la troposphère et qui sont en tout point comparables à la
lumière vont eux aussi subir des phénomènes de réfraction et ceci en
respectant les lois de l'optique. |
|
|
Quelques rappels d'optiques |
|||
| Projection verticale |
Passage d'un milieu
moins réfringent à un milieu plus réfringent |
Passage d'un milieu plus
réfringent à un milieu moins réfringent |
|
|
|
|
|
|
|
Pas de
déviation de trajectoire quand l'angle d'incidence vaut 90° même si les
deux milieux sont différents. |
La lumière passe d'un milieu - réfringent à
un + réfringent. L'angle réfracté est inférieur à l'angle incident |
La lumière passe d'un milieu + réfringent à
un - réfringent. L'angle réfracté est supérieur à l'angle d'incidence |
|
|
J'aurais dû faire ces dessins dans l'autre
sens pour tenir compte de la réalité physique, car quand nous sommes au
sol et transmettons, nos signaux passent d'un milieu plus réfringent vers
un milieu moins réfringent du moins pour la partie montante. Regardez la tête en bas... |
|||
|
Ceci nous amène vers la célèbre formule que
tous les élèves ont un jour ou l'autre eu à manipuler et qui dit : |
|||
|
|
n1 = indice de réfraction
du milieu 1 |
||
|
Cette formule nous permet connaissant les indices de réfraction et au moins un angle de déterminer l'autre ou connaissant les angles et au moins un indice de déterminer l'autre. |
|||
|
Portée optique et horizon radio : |
|||
|
On considérait, il y a longtemps, que la
distance maximum de liaison en VHF était limitée à la portée optique
entre deux stations. On peut aisément calculer cela en appliquant la
formule que vous trouverez ci-dessous. Fort heureusement, dans la pratique, cela fonctionne beaucoup mieux. L'avantage d'un tel calcul, c'est qu'il permet d'estimer votre portée radio en ligne droite quand vous êtes en point haut sur une montagne par exemple sachant que la portée radio est estimée à 4/3 de la portée optique. Calcul de la portée optique : |
|||
|
|
avec d en km et h en mètres |
||
|
A titre d'exemple, si vous êtes sur un point situé à 1000m de hauteur, votre horizon optique vaut : d= racine (17*1000) = 130 km |
|||
|
|
|||
|
Parlons de l'indice de réfraction de
l'air : |
|||
|
|
Nous venons de le voir, l'air est
caractérisé par un indice de réfraction. Cet indice de réfraction
évolue principalement en fonction des caractéristiques de température,
pression, et vapeur d'eau de l'atmosphère. Comme dans l'atmosphère ces paramètres décroissent d'une manière quasi monotone avec la hauteur, l'indice de réfraction diminue graduellement en fonction lui aussi de la hauteur. Si l'on relie les points d'indice de réfraction identique entre eux en fonction de l'altitude, on obtient en condition standard à peu près ceci. On peut faire figurer en abscisse soit une durée soit un parcours. |
||
|
Maintenant, en imaginant que nous émettions
un fin pinceau d'énergie haute fréquence, voire un faisceau lumineux (nous
sommes loin de la réalité), observons ce qui se passe entre deux stations
terrestres avec le schéma ci-dessous : |
|||
|
|
|||
|
Si nous souhaitons communiquer, il faut qu'à
un moment ou à un autre nos signaux retombent sur terre et ceci va être
merveilleusement réalisé par la nature qui à mis en place un indice de
réfraction décroissant avec l'altitude... En conditions normales, notre
signal va avoir le parcours suivant : |
|||
|
|
|||
|
J'ai représenté trois strates d'air ayant
des indices de réfraction différents, ceci n'est qu'un schéma sensé
démontrer le mécanisme, les irrégularités d'indice sont beaucoup plus marquées dans la réalité. |
|||
|
|
Notre rayon (appelons le comme cela) passe
d'un milieu d'indice n1 plus réfringent à un milieu d'indice n2 moins
réfringent. La théorie optique nous indique que dans ce cas de figure
l'angle du rayon réfracté par rapport à la normale (la verticale) est
supérieur à l'angle d'incidence, ce que j'ai tenté de détailler sur ce
schéma ci-contre. Tout ceci fait que le rayon est peu à peu rabattu vers
le bas et revient sur terre. |
||
|
Et voilà comment fonctionne le mode troposphérique. C'est grâce aux variations de pression, température,
vapeur d'eau et humidité relative que l'air change d'indice de réfraction
au fur et à mesure que l'altitude croît. Les ondes VHF sont réfractées
de proche en proche jusqu'à revenir sur terre. |
|||
|
Mais à quoi sont dues les super-tropos
? |
|||
|
Tout se qui précède a été défini comme
"conditions normales" et on entend par là une distribution
monotone de l'indice de réfraction en fonction de la hauteur. Ce sont les
conditions qui existent en permanence en VHF. Fort heureusement, pour
rompre la monotonie, la nature nous offre des spectacles grandioses et les
VHF ne font pas exception car il arrive que l'on passe de QSO à 500-700 km
à des QSO à 1500 km. Sur 144 MHz c'est plaisant, sur 432, 1296 MHz et au
dessus c'est franchement excitant. Nous allons tenter de décrire les causes qui amènent les évènements. |
|||
|
Et encore l'indice de réfraction : |
|||
|
|
Nous savons que tout cela ne fonctionne que
grâce à lui, donc fort logiquement, quand il y aura bonne tropo, l'indice
jouera un rôle important. Voici à gauche un monogramme tiré du VHF-UHF
manual et qui laisse apparaître la situation le 21 janvier 1974. A gauche les
pressions, donc les hauteurs, à droite la valeur de N, l'indice de
réfraction et en abscisse, un parcours qui débute en Grande Bretagne et
qui se termine à Berlin, en Allemagne. La chose intéressante à observer c'est que vers le milieu du parcours, on observe un tassement marqué des lignes iso-indiciaire (néologisme) et que c'est un gradient resserré de ces lignes qui permet d'avoir une bonne tropo. Si vous avez l'occasion de tomber sur ces relevés, notez bien qu'une bonne tropo est probable quand le gradient est resserré. Ces informations ne sont pas hélas à la portée de tous et leur détermination expérimentale à grande echelle est impossible. Pour mémoire le gradient correspond au taux de variation de la variable, en l'occurrence, l'indice de réfraction dans notre cas. Fort taux de variation pour une variation d'altitude donnée équivaut à gradient élevé, faible taux de variation pour la même variation d'altitude égale gradient faible. |
||
|
A droite, la situation un jour de bonne
tropo avec l'enregistrement du signal d'une station TV VHF dans la gamme 170 MHz
(partie supérieure du dessin).
On mesure clairement la corrélation entre fort gradient d'indice de
réfraction et fort signal. Les hauteurs sont spécifiées en millibars (maintenant en hecto Pascal). En faisant une légère approximation, on perd 1 HPa pour 9 m en conditions normales, c'est la décroissance de pression en fonction de la hauteur. Partant d'une pression au niveau du sol de 1013 HPa (par convention) le point 700 mb (ou 700 HPa) sera situé à : 1013 - 700 = 313 mb de différence 313 x 9 = 2817 m. Attention, ce sont des calculs approchés, seulement utiles pour situer l'ordre de grandeur. De même 1 mb n'équivaut pas tout à fait 1 HPa mais la différence est minime. |
|
||
|
Conditions d'établissement de bonnes
conditions troposphériques : |
|||
|
L'obtention d'un gradient d'indice de
réfraction tel que celui présenté ci-dessus n'est possible que lors de
circonstances météorologiques bien particulières et qui provoquent :
L'inversion de
température. |
|||
|
C'est le phénomène majeure responsable de belles ouvertures en tropo. De quoi est-il question ? |
|||
|
|
Voici une coupe verticale de la troposphère.
Partant du sol, on constate une diminution normale de la température liée
à l'augmentation d'altitude. A partir d'un certain point, la température
de l'air, au lieu de continuer sa décroissance, inverse la tendance et plus
l'altitude croît, plus la température augmente. Nous sommes dans la couche
d'inversion. Si nous poursuivons, nous constatons que l'inversion prend fin
et que la température de l'air décroît de nouveau tandis que croît
l'altitude. Nous quittons la couche d'inversion de température. Et
justement dans la couche d'inversion le gradient de l'indice de réfraction
est très élevé, c'est exactement ce dont nous avons besoin. |
||
|
On rencontre ce genre de situation dans des
situations météorologiques particulières. On distingue majoritairement
quatre cas : |
|||
|
Inversion de subsidence (affaissement) |
|||
|
|
||
|
Inversion d'advection |
|||
|
|||
|
Inversion de rayonnement |
|||
|
|||
|
Inversion liée à un passage de front |
|||
|
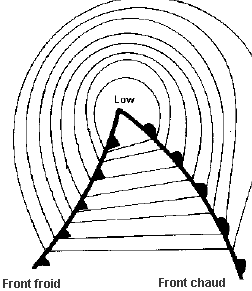
|
||
|
Remarquez au passage que de bonnes conditions sont
toujours accompagnées de hautes pressions mais que l'établissement de
hautes pressions ne signifie pas systématiquement l'arrivée de bonnes
conditions. |
|||
|
Le tropo-scatter: |
|||
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
Le Ducting : |
|||
|
|||
|
|
|||
|
Le QSB ou fading si caractéristique en
V/UHF : |
|||
|
|||
|
Absorption de l'atmosphère : |
|||
|
|||
|
|
|||
|
Rain Scatter : |
|||
|
|||
|
L'intérêt du trafic en point haut : |
|||
|
|||
|
Les prévisions : |
|||
|
|||
|
Bon, nous avons fait un petit pas vers la
connaissance de la propagation troposphérique. Il reste encore beaucoup à
dire et certainement à découvrir. Le prochain chapitre sera consacré aux
autres modes que l'on rencontre en V/UHF. Nous y passerons en revue la
FAI, l'ES, le MS, L'EME , La TE, l'Aurore. A tout à l'heure... |
|||
| Retour vers la page d'accueil du traité |
| Retour vers la page d'accueil du site F6CRP |
| Conception-réalisation : Denis Auquebon F6CRP |