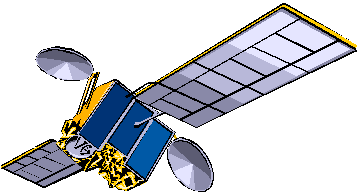
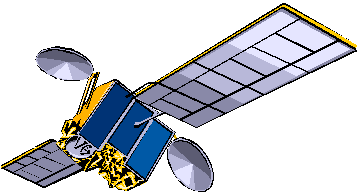
Réalisation
: Anthony BOURGUIGNON, Nicolas DA SILVA, Frédéric THAUVIN.
IUT
de Blois Département GTR: Projet
de Fin d’études
Cet exposé a été réalisé pour la présentation d'un projet de fin d'étude à l'IUT de Blois
INTRODUCTION *
I) Un peu d’Histoire : *
II) Que peut on faire quand on est radioamateur ? *
IV) Principes généraux de la radiocommunication*
VII) Le matériel utilisé par les radioamateurs*
INTRODUCTION
Le but de ce projet était à l’origine de proposer à 3 étudiants de passer le concours donnant l’accès au service des radioamateurs. Mais un malheureux changement de législation nous conduit à abandonner ce but. En revanche nous avons continué à travailler dans cet objectif pour proposer aujourd’hui une présentation du monde des radioamateurs et des transmissions Hertziennes.
A travers ce dossier vous allez pouvoir découvrir le monde des radioamateurs : comment devenir radioamateur, pourquoi des radioamateurs, que font les radioamateurs, comment transmettre...
Nous vous présenterons également différents types
d’émissions et de modulations utilisées.
Ce premier radioamateur effectuera de nombreux essais en collaboration avec des Américains. Un an plus tard le 2eme radioamateur recevra son indicatif dès lors tout s’accélèra, depuis la première liaison bilatérale transatlantique au téléphone cellulaire par satellite tous ces hommes ont participé à l’évolution des techniques de transmission de l’information par les ondes hertziennes.
Les premières transmissions ont eu lieux en code Morse créé par Samuel Morse (encore utilisé par les radioamateurs), puis la téléphonie apparue (transmission de la voie) en utilisant différentes modulations AM, FM, USB que nous verrons plus tard. Aujourd’hui les radioamateurs utilisent l’informatique pour transmettre des données numériques et une myriade de satellite pour effectuer leurs transmissions.
Les radioamateurs utilisent les techniques les plus modernes pour satisfaire
leurs passions : la technique, la communication...
La pratique de l’émission d’amateur est très réglementé et stricte. Chaque contact effectué avec un radioamateur doit être consigné dans un " journal de trafic ", celui ci comporte les indicatifs des radioamateurs contactés, l’heure, la date des contacts, la modulation utilisée. Ce document peut être demandé à chaque instant par l’administration compétente.
Les radioamateurs ne peuvent échanger que des informations ayant trait à l’émission amateur, c’est à dire à la technique ( électronique, informatique, radioélectricité...). Mais les radioamateurs élargissent ce champ de discussion : Savoir quelles sont les passions de l’autre, avoir une idée de la météo, obtenir des renseignements sur la ville où il habite etc ... Ceci contribue à créer des liens qui font que, un jour, cet opérateur contacté par hasard vous rappellera s’il vous entend. On peut ainsi entretenir son vocabulaire dans une langue étrangère, tout en maintenant des liens d’amitié avec un radioamateur situé à des milliers de kilomètres.
La langue universelle est bien évidement l’Anglais.
La chasse aux stations rares constitue une activité passionnante. Imaginez seulement que certaines petites îles du Pacifique ne sont pas habitées et que, pour quelques jours, une équipe de radioamateurs décide d’y faire une " expédition ". Emettant avec un indicatif spécial, cette station va véritablement déchaîner un trafic de tous les coins du monde. Les radioamateurs de tous les pays, mis au courant de l’expédition, vont tenter d’établir un contact qu’ils ne renouvelleront peut-être jamais. Là, si l’on ne dispose pas d’une grande puissance, il conviendra d’être astucieux pour se faire entendre au milieu du brouhaha.
Objet d’une chasse au diplôme, ou simple élément d’une collection peu ordinaire, la carte QSL matérialise le premier contact établi avec une station. Son nom vient du code Q, utilisé en télégraphie, et signifie " accusé de réception ". Elle est vite devenue la " carte de visite " du radioamateur.
Chacun met un point d’honneur à concevoir une carte originale, humoristique, image de son pays ou reprenant un thème technique.
Ces cartes sont envoyées directement, à l’adresse de leur destinataire (un répertoire mondial des radioamateurs est édité chaque année) ou transitent par un bureau spécialisé, géré par les associations nationales. Cette dernière solution étant plus économique.
Après quelques années de trafic ou d’écoute, on possède plusieurs centaines de cartes constituant une collection qui étonne toujours.
Les radioamateurs peuvent se voir décerner des diplômes émanant de la communauté international des radioamateurs. Le plus célèbre, le DXCC, demande au postulant d’avoir contacté au moins 100 contrées différentes (pays ou régions de pays) parmi les quelques 350 reconnues. Comme preuve du contact, il faut fournir cette fameuse carte que l’on obtient normalement après quelques semaines. Là commence l’angoisse car certains radioamateurs peu scrupuleux n’envoient la carte que très tard, voire jamais ! Si ces diplômes n’ont rien d’académique, ils donnent un but au trafic de tous les jours.
Un opérateur seul, bien organisé et entraîné, dépassera le millier de liaisons.
Un classement national ou international intervient. Figurer dans les
premières places est un honneur et une récompense. Beaucoup
d’amateurs profitent de ces concours pour aligner des nouveaux pays à
leur tableau de chasse.
Le nombre de points obtenus est, selon les concours, fonction du nombre de liaisons établies, des zones géographiques contactées, des préfixes accumulés etc...
Pendant ces journées, le trafic au sein d’un radio-club trouve tout son intérêt. Les opérateurs se succèdent au micro ou au manipulateur, d’autres les assistent pour noter les liaisons établies ou préparent la cuisine et les boissons. En principe, l’ambiance est au beau fixe et la bonne humeur de rigueur.
Conçus comme des rencontres sportives, les concours offrent en
récompense des coupes que l’on garde jalousement et qui sont fièrement
exhibées. Il n’est pas rare, en fin de manifestation, d’entendre
des opérateurs à la voix éraillée, fatigués
de lancer des appels mais contents d’avoir améliorer leur précédent
score.
Le service radioamateur est reconnu par l’administration qui en donne la définition suivante :
" ... service de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire... "
La législation est l’ensemble des règles que doivent respecter les radioamateurs :
La classe 1 : cette classe donne accès à toutes les bandes de fréquences du service amateur.
L’épreuve donnant accès à cette classe est la plus dure à passer, elle se compose de 20 questions portant sur la réglementation des radioamateurs et des conditions de mise en œuvre des installations du service amateur , 20 questions portant sur la connaissance de la technique de l’électricité et de la radioélectricité et comprend une épreuve de télégraphie ou l’opérateur doit être capable de décoder 12 mots/minute codés en morse.
Classe 2 : cette classe donne accès a toutes les fréquences supérieures à 30Mhz.
L’épreuve donnant accès a cette classe comprend 20 questions portant sur la réglementation des radioamateurs et des conditions de mise en œuvre des installations du service amateur et 20 questions portant sur la connaissance de la technique de l’électricité et de la radioélectricité. Cette épreuve ne comprend pas de télégraphie.
Classe3 : Cette classe a été créée pour permettre à des novices de pourvoir découvrir le monde du radioamateurisme.
L’épreuve comprend 20 questions portant sur la réglementation des radioamateurs et des conditions de mise en œuvre des installations du service amateur.
Toutes ces épreuves se passent dans un centre d’examen sur Minitel. Le questionnaire et du type QCM :
Une bonne réponse 3 points
Pas de réponse 0 point
Réponse fausse –1 point
Une fois votre licence obtenue vous pouvez faire la demande de votre indicatif à l’administration. Cette indicatif est unique, chaque radioamateur possède le sien qu’il utilisera lors de toutes ses émissions . Il se compose de lettres et de chiffres. Vous trouverez ci-dessous la composition de cet indicatif pour la France.
Voir annexes
L’autorisation d’utiliser une station d’amateur est soumise à une taxe annuelle de 300F.
Chaque passage de l’examen coût 200F.
De nombreuses associations spécialisées dans le radioamateurisme tel que le REF-UNION
(réseau des émetteurs français-union française
des radioamateurs ) permettent une bonne utilisation du réseau hertzien
et fournissent de nombreuses informations à leurs utilisateurs.
Il s’agit, à partir d’un signal son ou image par exemple, de transmettre cette information ( nous appelons information ce qui doit être transmis ) afin qu’elle puisse " s’échapper " et aller vers le récepteur.
Avant d’aborder le principe général, comprenons certains éléments de base :
Vous entendez souvent parler de modulation de fréquence, modulation d’amplitude et parfois de BLU ( bande latérale unique ). Il s’agit en outre de fréquences acoustiques qui directement transformées en fréquences électromagnétiques ( toujours entre 20 Hz et 15 Khz ) n’iraient pas bien loin et seraient inexploitables aussi faut-il leur procurer un support électromagnétique de fréquence plus élevée qu’on appelle " porteuse ". La porteuse est donc modulée par l’information.
La modulation peut se faire par deux moyens :
La modulation d’amplitude consiste à faire varier l’amplitude de la porteuse à la fréquence du signal audio. Il s’agit tout simplement de mélanger deux fréquences, l’une haute et l’autre basse. Le signal obtenu étant leur somme et leur différence.
La modulation en bande latérale unique n’est qu’un cas particulier
de la modulation d’amplitude.
Ici, contrairement à la modulation d’amplitude, la fréquence de la porteuse varie au rythme de la fréquence audio, son amplitude reste constante. Pour obtenir une modulation efficace et de haute fidélité, une porteuse FM occupe beaucoup plus de place qu’une porteuse AM, aussi, ne l ’utilise-t-on que sur des fréquences très élevées au-dessus de 30MHz. En outre son amplitude constante permet d’éliminer tout parasite en réception sans altérer la qualité de la modulation.
Comme la BLU en AM, la modulation de phase est un cas particulier de
la modulation de fréquence.
Réduit à sa simple expression, un émetteur peut donc être composé :
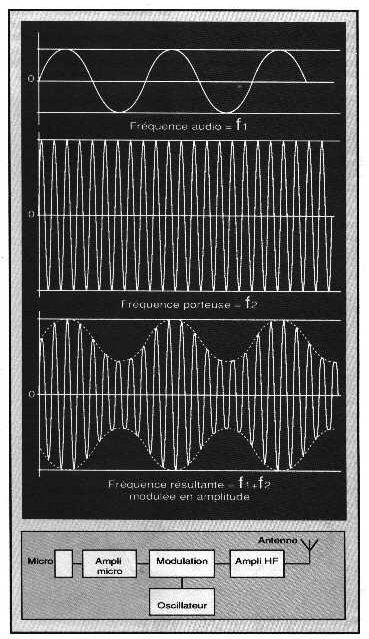
Schéma synoptique d’un émetteur
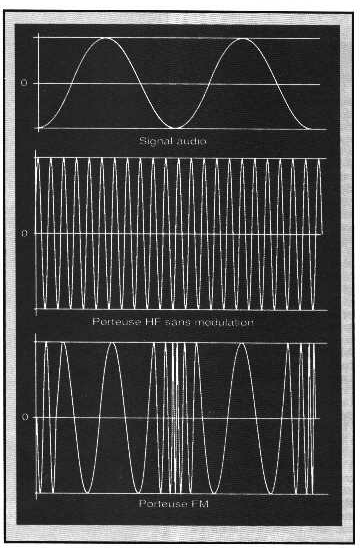
Rôle et caractéristiques principales d’un récepteur :
L’objet du présent paragraphe est de préciser le rôle d’un récepteur, particulièrement un récepteur de radiocommunication, puis de passer en revue les caractéristiques principales de cet équipement.
Rôle d’un récepteur :
Un récepteur de radiocommunication a pour but de recevoir une information qui lui est destinée ou qui l’intéresse. Pour cela il est associé à une antenne chargée de capter l’onde électromagnétique provenant d’une autre antenne associée à un émetteur dont la porteuse a été modulée par un signal correspondant à l’information précitée.
Démodulation :
Ce n’est pas la porteuse qui intéresse l’utilisateur du récepteur mais l’information qu’elle porte. C’est pourquoi la fonction qu’il est indispensable d’assurer dans un récepteur est la démodulation du signal haute fréquence reçue.
Amplification avant démodulation et sélectivité :
La démodulation ne peut se faire dans de bonnes conditions que si le signal modulé appliqué à l’entrée du démodulateur possède l’amplitude et par conséquent la puissance requise. Cette puissance est très supérieure à la puissance du signal reçu à l’entrée du récepteur dans lequel il est donc nécessaire d’assurer l’amplification avant démodulation requise.
Le seul signal qui doit atteindre l’entrée du démodulateur est celui dont le spectre occupe la largeur de bande nécessitée à l’émission par le type de modulation et le type de signal modulant utilisés. Le récepteur doit donc effectuer un rôle de sélectionneur avant démodulation. Cette sélectivité peut être réalisée soit par filtrage, soit par amplification sélective avant la démodulation.
Amplification après démodulation :
Le signal délivré par le démodulateur doit généralement être amplifié pour pouvoir être utilisé de manière valable.
Modulation :
En modulation d’amplitude, le démodulateur utilisé est un détecteur d’enveloppe car la variation d’amplitude du signal reçu, c’est à dire son enveloppe , n’est autre que le signal modulant.
En modulation de fréquence, le démodulateur utilise un dispositif appelé discriminateur de fréquence, lequel est normalement précédé d ’un limiteur d’amplitude. C’est l’ensemble limiteur + discriminateur qui constitue le démodulateur.
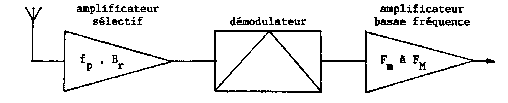
Schéma synoptique d’un récepteur
V)
Présentation des principales modulations utilisées par les
radioamateurs
1) Modulation
à bande latérale unique
L’expression temporelle est la suivante :
b) Réalisation de la modulation
d) Démodulation d’un signal BLU
Comme en modulation DBSP, la modulation BLU fait intervenir une modulation inverse. C’est à dire que l’on multiplie le signal modulé sBLU(t) par une porteuse reconstituée (égale à la porteuse utilisée lors de la modulation), le signal ainsi obtenu est ensuite filtré par un filtre passe-bas.
Cependant, si cette porteuse diffère de celle utilisée lors de la modulation, les effets suivants peuvent apparaître :
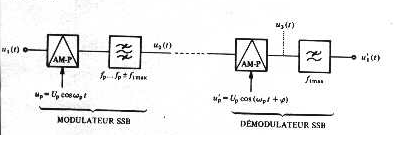
2) Modulation de fréquence
fi(t) = fo+kfm(t) où kf est la caractéristique du modulateur en Hz/V
Il ne s’agit pas d’une simple multiplication de 2 signaux.
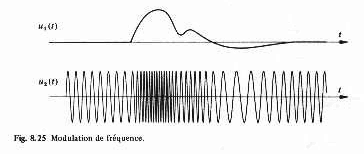
b) Définition de l’indice de modulation
b = (excursion max de fréquence / largeur de bande du signal m(t) )
= (kf |mmax(t)| / b)
c) Spectre d’un signal modulé en FM
sFM(t) = A cos(2p f0t + (kfam / fm) sin(2p fmt))
Ce qui donne : 2p kf ò m(u)du = 2p kVCO ò s(u)du
d’où s(t) = (kf / kVCO) m(t)
Cette forme de démodulation est courante et économique. Il existe cependant une autre forme de démodulation.
Elle consiste à transformer un signal FM à l’aide d’un discriminateur puis d’effectuer une détection d’enveloppe.
On a : sFM(t) = Acos(w0t + j (t)) où j (t) = 2 p ò kf m(u)du
Ce qui donne après dérivation : (dsFM(t) / dt) = -A (w 0 + j ’(t)) sin (w 0t + j (t))
= -A (w 0 + 2p kfm(t))
= -A.2p (fo + kf m(t))
Cette dérivation suppose que l’amplitude des signaux reçus est constante. Pour éviter les phénomènes de variation et de distorsion du signal, il est indispensable d’écrêter le signal avant de le dériver.
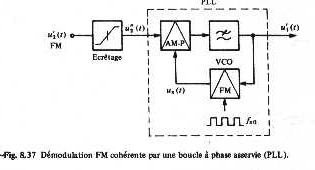
3) modulation d’amplitude
a) Principe de la modulation AM
sAM(t) = [1+km(t)] cos(2p f2t)
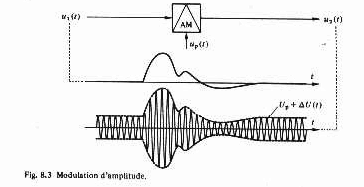
b) Spectre, largeur de bande et taux de modulation
sAM(t) = cos (2p f2t) + km(t).cos (2p f2t)
Son spectre est alors de la forme :
SAM(f) = ½ [d (f - f2) + d (f + f2)] + m ½ [d (f - f1) + d (f + f1)] Ä ½ [d (f - f2) + d (f + f2)]
= ½ [d (f - f2) + d (f + f2)] +m/4 [ d (f - f2 - f1) + d (f - f2 + f1) + d (f + f2 - f1) + d (f + f2 + f1)]
On peut déduire du calcul que le spectre unilatéral du signal modulé se compose :
sAM(t) = [1+ m.cos(2p f1t)] cos(2p f2t)
c) Démodulation par détection d’enveloppe
La démodulation par détection d’enveloppe se fait par redressage du signal reçu puis filtrage dans le cas où l’enveloppe est positive. Soit sr(t) le signal après redressage :
sr(t) = Ö (sAM(t))²
= [1+km(t)] . Ö cos²(2p f2t) car l’enveloppe est toujours positive
Le résultat nous donne un spectre de sr(t) (après convolution des 2 termes de sr(t) ) composé de raies aux fréquences 0, 4f2, 8f2, ... avec 2 raies latérales autour de ces fréquences. Un simple filtrage passe-bas à f1 permet d’obtenir un signal semblable a une constante près en sortie du démodulateur. Si l’enveloppe du signal ne reste pas positive, il faut utiliser un autre procédé de démodulation.
VI) Différents modes de
trafic
A l ’origine, les liaisons s’effectuaient uniquement en télégraphie, en utilisant le code Morse. Croyez-vous que ce type de transmission soit démodé ? Et bien , vous vous trompez: il demeure le plus efficace en cas de parasites et de brouillages. Bien sûr, l’apprentissage de ce code demande un petit effort personnel. Cet effort sera vite récompensé par le plaisir que l’on peut éprouver à écouter des messages transmis en télégraphie. La période d’apprentissage sera fonction du temps que l’on consacrera, quotidiennement de préférence, à cette activité. Tout comme pour la musique , l’oreille doit être éduquée et seule la pratique permet de progresser. L’immense avantage de la télégraphie , c’est que l’on peut aisément construire son émetteur sans qu’il soit nécessaire de posséder un important matériel de mesure.. et sans trop y investir d’argent. Pour réussir le contrôle de connaissance, auquel doivent se soumettre les radioamateurs désirant trafiquer en télégraphie, il faut être capable de lire des messages à la vitesse de 10 mots par minute. Les opérateurs entraînés trafiquent à des vitesses supérieures à 20 voire 30 mots par minute. Souvent les liaisons à très grandes distances ( on dit DX ) ont lieu en télégraphie car les signaux sont faibles.
C’est ainsi que l’on nomme les transmissions permettant d’utiliser directement la parole. Ce procédé ne demande aucune disposition particulière de la part de l’opérateur, le minimum concernant les procédures de trafic devant être acquis lors du contrôle de connaissances. Une question vient immédiatement à l’esprit : comment font les radioamateurs du monde entier pour discuter entre eux ? La réponse est simple : ils utilisent l’anglais qui est la langue la plus répandue dans le monde. Pas besoin de sortir d’Oxford pour établir une liaison avec un Russe ou avec un Japonais car il existe un minimum de mots permettant de se comprendre. Certains opérateurs ne connaissent d’ailleurs que cette phraséologie de base. Par contre, si l’on veut dialoguer plus longtemps avec un Anglais ou un Américain, on trouvera là un champ d’application de l’enseignement qu’on aura pu recevoir à l’école. De même, il est permis de s’exprimer dans la langue du correspondant pourvu que l’on soit capable de la pratiquer suffisamment. On le voit, le radioamateurisme est un excellent moyen de cultiver les langues étrangères pour peu qu’on le désire.
Les très hautes fréquences :
Les débuts de la radio ont fait largement usage des ondes courtes. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour des liaisons à plus courtes distances, il est possible d’utiliser ce que l’on nomme les VHF ou UHF (Very High Frequencies et Ultra High Frequencies ). En théorie, ces ondes ne se propagent qu’en ligne droite et ont une portée " optique " . La pratique est fort différente et l’expérimentation sur ces fréquences est un vaste champ ouvert sur le futur. L’immense avantage de ces gammes d’ondes est qu’elles sont moins perturbées par les parasites et surtout, beaucoup moins occupées. Elles réservent d’excellentes surprises à leurs amateurs et avec un peu d’expérience, on peut y réaliser des liaisons exceptionnelles à très grande distance, l’été ou sous certaines conditions météorologiques. On le voit , les sciences se rejoignent fréquemment dans la vie quotidienne du radioamateur.
Les radioamateurs sont également autorisés à transmettre des images. Nous ne rentrerons pas dans des détails trop complexes mais, en ondes courtes , et avec un minimum de moyens, on peut échanger des images fixes ( un peu comme un diaporama ), d’un bout à l’autre du monde. En UHF, on peut procéder à des émissions de télévision , y compris en couleur. La portée est beaucoup plus limitée. Pas question de diffuser un western : seules les prises de vues en relation directe avec les activités des radioamateurs sont autorisées. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, un ensemble d’émission-réception télévision est plus facile à construire et à mettre au point qu’un émetteur-récepteur d’ondes coutres performant.

Un aspect intéressant du fax similé : La SSTV
SSTV est l’abréviation de Slow Scan Télévision
(en français: télévision à balayage lent) par
opposition à l’abréviation FSTV (Fast Scan Télévision
- télévision à balayage rapide) plus connue sous le
nom d’ATV (Amateur Télévision). Le principe fondamental de
la SSTV est de permettre aux radioamateurs de transmettre des images fixes
à l’aide d’une bande passante réduite correspondant à
celle de la parole.
Bien que la SSTV existe depuis plusieurs décennies, elle a toujours
été quelque peu boudée par les radioamateurs à
cause des coûts importants qu’elle implique et de la complexité
technique rendant difficile une conception "home made"... Cette situation
pourrait cependant changer du tout ou tout durant les mois à venir.
En effet, la démocratisation de l’informatique permet l’implantation
des ordinateurs dans un nombre sans cesse croissant de foyers, à
plus forte raison dans les repères mystérieux de radioamateurs
toujours à la pointe du progrès technologique ! Bonne nouvelle
pour ces derniers : l’ordinateur remplace aujourd’hui à très
bon compte les équipements SSTV complexes et onéreux de l’époque
!
Pour la réalisation de l’interface nous avons utilisé
le modèle HamCom dont voici le schéma, typons et nomenclature.
Schéma
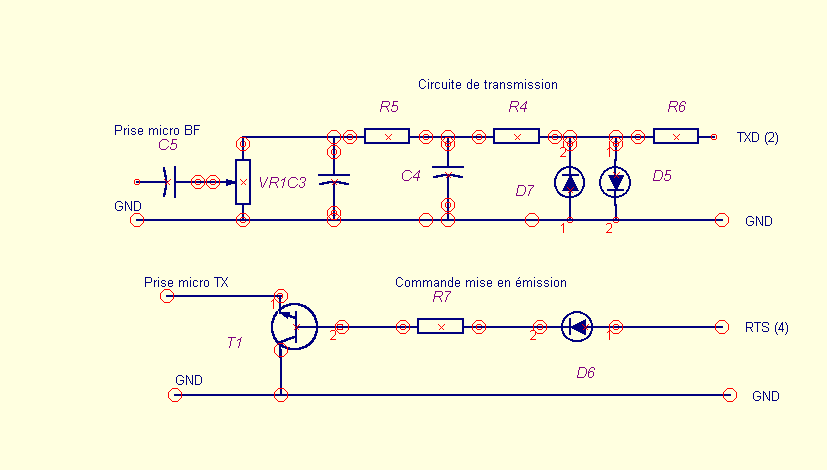
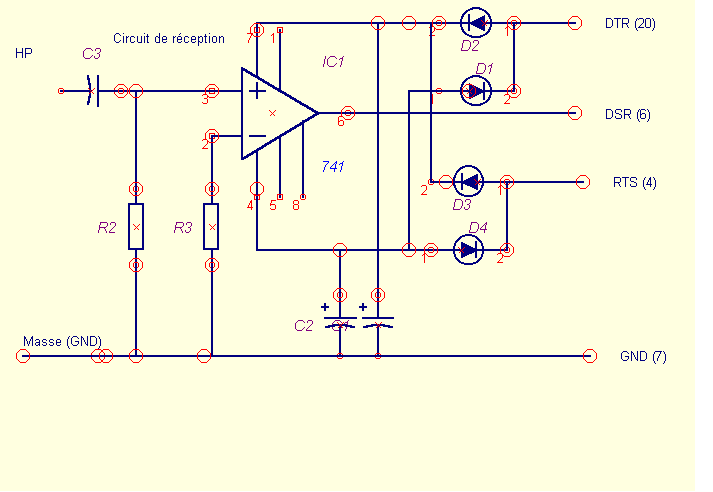
Nomenclature
R2 100KW
R3 100KW
R4 15KW
R5 15KW
R6 10KW
R7 1KW
C1 10uF
C2 10uF
C2 22nF
C4 22nF
C5 100nf
De D1 à D7 1N4148
T1 2N2222
CI LM741
Prise RS232
Principe de l’interface
Réception : Le signal est reçu par l’AOP (ampli opérationnel ), ce signal est une succession de sinusoïde qui sont convertie grâce au montage comparateur , en signaux numériques de fréquence proportionnel aux fréquences des sinusoïdes. Un fois en possession de ce signal, il ne reste plus qu’a l’envoyer à la prise RS232 (port COM) de l’ordinateur.
L’AOP est alimenté par la prise RS232 via le pont de diodes.
Emission : Le signal émis par le PC via la prise RS232 est de forme " carré " il faut le convertir en forme sinusoïdale grâce a l’utilisation de circuit RC. Ce signal est envoyé au transeiver qui appliquera la modulation souhaitée.
La gamme des fréquences utilisées est comprise entre 300 Hz et 3400 Hz (bandes de fréquences de la voie).
Le Logiciel
Caractéristiques:
Etant donné qu’un tel canal ne permet de transmettre qu’un phénomène variant dans le temps, la structure spatiale de l’image doit tout d’abord être convertie en une structure répartie dans le temps et ensuite reconvertie. Cette opération est effectuée par le balayage ligne par ligne de l’image, comme si l’image était découpée en un certain nombre de petites bandes étroites, puis en points (cf. Fig 1), dont la variation de la luminosité est transmise successivement et reconstituée de l’autre côté en lignes complètes.
Pour ne pas perdre la richesse des détails d’une image, il faut que cette dernière soit décomposée en un nombre de lignes aussi grand que possible et que chaque ligne compte le plus grand nombre possible de points d’image. Mais plus cette décomposition est grande, plus grandes seront les exigences auxquelles devra satisfaire le canal de transmission. En général, dans le domaine de la SSTV assistée par ordinateur, le pixel est utilisé comme unité de décomposition.
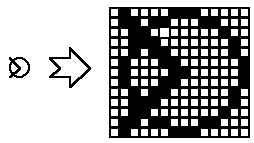

Figure 1. Décomposition d’une image en points
Le système "balaye" alors l’image pixel après pixel et,
au travers du modem, envoie au transceiver les fréquences correspondantes
les unes après les autres, d’où les sonorités étranges
d’une transmission SSTV! A la réception, le transceiver recueille
séquentiellement les différentes fréquences et les
transmet à l’ordinateur au travers du modem. Chaque fréquence
est reconvertie en niveau de gris et est affichée sur l’écran
de la station réceptrice.
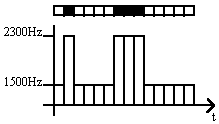 Figure
2. Codage de la première ligne de la figure 1.
Figure
2. Codage de la première ligne de la figure 1.
En plus des pixels, le protocole code également des événements importants, à savoir le début de la transmission de l’image, ainsi que la fin de chacune des lignes balayées. Dans le mode SSTV 8 secondes noir/blanc étudié, le début de transmission correspond à une fréquence de 1200 Hz transmise pendant exactement 30 ms.
A la réception de ce signal (appelé signal de synchronisation verticale), l’ordinateur de la station réceptrice se prépare à recevoir l’image proprement dite. Ensuite, à la fin de chaque ligne balayée, le système émetteur envoie un signal de 1200 Hz pendant exactement 5 ms. A la réception de ce signal (appelé signal de synchronisation horizontale), l’ordinateur de la station réceptrice "comprend" qu’il est temps de passer à la ligne suivante. Ce principe évite au récepteur de recevoir des images complètement de travers !
Le protocole Robot se différencie quelque peu des autres sur ce point, codant les couleurs selon les principes de luminance et de chrominance, plutôt que selon le système RGB.
Ces conventions ou règles sont appelées procédures de transmission, ou encore protocoles. Les protocoles de transmission SSTV peuvent raisonnablement être groupés en cinq groupes:
Outre un codage des couleurs différents, le protocole Robot utilise une séquence de synchronisation verticale plus longue, contenant 7 bits d’information et un bit de parité. Ce système permet une identification automatique du format de l’image transmise.
Les opérateurs d’Amérique du Nord apprécient énormément
le protocole Scottie S1 (80% des images sont envoyées dans ce mode).
Les 20% restants étant répartis entre les protocoles Scottie
S2, Martin M1, Robot 36 et 72.
Les opérateurs du Japon préfèrent les protocoles
Robot et AVT.
En Europe, enfin, les 95% du trafic SSTV est effectué à
l’aide du protocole Martin M1.
| FAX | 144.700 MHz | 432.700 MHz | 433.700 MHz | 1296.700 MHz |
| SSTV | 144.500 MHz | 432.500 MHz | 433.400 MHz | 1296.500 MHz |
| SSTV/FAX | 3.730 - 3.740 MHz | |
| 7.035 - 7.040 MHz | ||
| 14.225 - 14.235 MHz | Region 1 (Europa and Africa) | |
| 21.335 - 21.345 MHz | ||
| 28.675 - 28.685 MHz | ||
Activité SSTV CB sur 27’700 MHz
| QRG | 144.6125 MHz |
| Puissance | 8 W |
| Modulation FAX et SSTV | FM |
| Antenne | dipôle vertical |
| Emplacement | JN47LI, Hörnli, 1133m |
| Heures d’émission | 8.00 - 24.00 UTC |
| Fribourg (Suisse) | mardi de 20h30 à 22h00 CET | 439.000 MHz (HB9FG) | FM |
| Verviers (Belgique) | samedi à 10h30 CET | 144.500 MHz (ON4PL) | FM |
| EUREGIO (Aachen/PA/ON) | lundi dès 20h00 CET | 144.350 MHz (DL4KCK) | SSB |
| lundi dès 21h30 CET | 144.700 MHz (DL4KCK) | FM | |
| F06 (JO40) | mercredi dès 20h30 local | 144.500 MHz | FM |
| mercredi dès 20h30 local | 433.400 MHz | FM | |
| F34 (JO40ST) | mardi à 20h00 CET | 439.000 MHz (DB0UQ) | ? |
| Copenhague (Danemark) | 144.500 MHz (OZ9SSTV) | FM |
| (Australie) | 147.475 MHz (VK4GO) | FM |
| (Belgique) | 433.925 MHz (ON4VRB) | FM |
| 28.700 MHz (ON4VRB) | SSB |
5) Les transmissions digitales :
L’information échangée est sous forme de messages écrits. Les plus connus sont les télex comme ceux des agences de presse. Les radioamateurs en ont développé bien d’autres et les machines mécaniques, bruyantes et sales, cèdent leur place aux micro-ordinateurs beaucoup plus puissants.
On peut recevoir des bulletins d’information sur la propagation, les expéditions lointaines, la vie associative, tout en étant absent de chez soi , après avoir réglé son récepteur sur la bonne fréquence. Des techniques encore plus modernes, telle que la transmission par paquets ( très proche du transpac utilisé par les entreprises ou le Minitel), sont rapidement passées du stade expérimental au stade opérationnel.
D’immenses réseaux se constituent à travers tous les pays,
permettant d’échanger des informations en utilisant d’autres stations
radio comme relais. Tout l’intérêt de ces modes de liaisons
c’est que l’on peut conserver une trace écrite des différents
messages. De plus en plus , la tendance est à l’utilisation de boites
aux lettres dans lesquelles on peut laisser un message destiné à
d’autres correspondants .
Un aspect des plus intéressant des modes digitaux pour un futur
technicien réseau, Le Packet-Radio :
Le packet-radio qu’est-ce que c’est ?
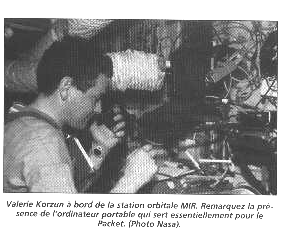
Le packet-radio concerne une grande partie de la communauté radioamateur mondiale. Certains, même, n’ont pas hésité à en faire leur activité principale. D’autres l’ont abandonné au profit d’internet, jugé plus fiable et plus rapide; mais là ce n’est plus de la radio ! Mais qu’est-ce dont que le packet-radio et à quoi ça sert ?
Le packet est un moyen de communication faisant appel à la transmission de données entre ordinateurs au moyen de la radio. Le principe est très proche d’internet, excepté qu’au lieu d’utiliser le téléphone, on utilise les ondes hertziennes. L’équipement nécessaire se limite à un ordinateur, un TNC (terminal node controller ) et un émetteur-récepteur. Il existe d’autres moyens de convoyer des données, mais le packet-radio reste le mode le plus utilisé, notamment en VHF. La majeure partie des informations transmises consiste en des textes bruts. Mais sachez qu’il n’y a pratiquement aucune limite quant à la forme des données transmises, excepté les restrictions légales.
De loin, le plus gros du trafic consiste en des bulletins et des messages personnels distribués à un individu, un groupe d’individus, ou encore globalement. Certains radioamateurs volontaires et très généreux ont des stations qui fonctionnent à longueur de journée et à longueur d’année pour permettre le transfert des messages vers d’autres stations similaires. Ce sont des BBs ( bulletin board system ) sur lesquels sont déposés des messages et où l’on peut récupérer des données. Il y en a partout en France et dans le monde, voire même dans l’espace. Ces stations sont le plus souvent automatiques. Ils reçoivent les messages des utilisateurs et les distribuent à qui de droit. La plupart des messages sont des bulletins destinés à un large public. Ces bulletins sont spécialisés dans les informations sur le DX, les nouvelles des satellites, la vie associative, etc.
Il y a aussi une bonne quantité de petites annonces et de messages émanant d’individuels qui recherchent des informations. En somme, c’est une sorte de forum comme on en trouve sur internet. La destination du message, définie par celui qui l’envoie, peut aller d’une personne en particulier à tous les radioamateurs du monde. Par exemple, un message adressé à tous sera systématiquement transmis aux bbs français. Un message adressé à WW ( comme worlwide ) sera diffusé aux bbs du monde entier. Un message peut aussi être adressé à un radioamateur particulier. Le bbs distribue le courrier d’une manière très simple. Il crée un fichier de messages destinés à d’autres bbs et les transmet régulièrement aux bbs voisins. Ces derniers, à leur tour, retransmettent les messages qui ne les concernent pas directement, et ainsi de suite jusqu’à ce que la ou les stations concernées soient atteintes.
Le réseau n’étant pas parfait, un message destiné à une station située à quelques centaines de kilomètres de l’expéditeur peut parfois voyager pendant des milliers de kilomètres avant d’arriver. En général, seulement quelques-uns des nouveaux messages arrivant chaque jour sur un bbs particulier sont lus par ses utilisateurs locaux. Par exemple, sur 30 nouveaux messages, il se peut que vous ne soyez intéressé que par un ou deux d’entre eux.
Certains radioamateurs intéressés par le trafic HF au-delà de nos frontières passent plus de temps sur le réseau packet-radio VHF, car autre chose les attire : c’est le PacketCluster . Ce système consiste en un genre de bbs fonctionnant en temps réel. Les DX’eurs s’y connectent et attendent des spots. Ceux-ci sont envoyés par d’autres stations connectées au Cluster et consistent en de courts messages contenant un indicatif, une fréquence et parfois un commentaire comme une info QSL par exemple.
La tradition veut que l’on tente d’envoyer plus de spots que son voisin, ce afin d’aider les autres utilisateurs dans leur quête des pays rares. Le bon DX’eur n’est pas celui qui profite du cluster, mais celui qui l’anime. En quelques mots, le cluster sert à se passer des informations DX en temps réel. Il n’est d’ailleurs pas seulement utilisé pour la HF, mais aussi lorsque des ouvertures intéressantes se produisent sur les bandes VHF, UHF et SHF. Parfois, lorsque les utilisateurs sont nombreux, plusieurs clusters se connectent entre eux, augmentant les possibilités de circulation de l’information. Certains clusters offrent aussi des services aux utilisateurs, comme l’accès à un CD-ROM contenant l’annuaire des radioamateurs .
Le packet peut aussi servir pour faire des QSO dits de clavier à clavier. Cela consiste à se connecter directement à un autre utilisateur et de procéder à une conversation tout à fait ordinaire. Cela permet, entre autres, de réunir les membres d’un même radio-club et ainsi éviter de se déplacer. Le packet-radio a beaucoup évolué depuis sa naissance au début des années 1970.
On y pratique maintenant le TCP/IP, la transmission d’images et encore bien d’autres choses. C’est une très brève description de ce mode de trafic, mais cela devrait permettre aux novices de mieux comprendre son utilisation.

Une antenne de réception est un conducteur qui reçoit des ondes magnétiques et qui les transforment en énergie électrique.
Caractéristiques principales d’une antenne :
Une antenne est polarisée pour recevoir une certaine polarisation d’onde.
Prenons un exemple :
Si un émetteur possède une antenne polarisée verticalement pour que la réception soit maximale il faut que le récepteur utilise une antenne possédant la même polarisation. En théorie si l’antenne réceptrice est polarisée verticalement le récepteur ne pourra pas recevoir l’information. En réalité cette différence de polarisation provoque une atténuation de 20 dB environ.
Il existe trois types de polarisations :
- Elliptique
canaux on alterne la polarisation.
b) Le diagramme de rayonnement :
Le diagramme de rayonnement représente la direction de réception
ou d’émission du champ électrique d’une antenne. Le diagramme
varie suivant la conception de l’antenne.
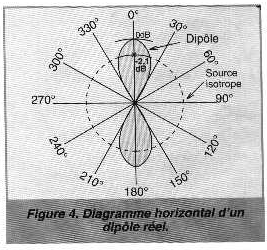
Exemple de diagramme de rayonnement Dipôle demi-onde.
On voit qu’il apparaît 2 lobes tangents en 0. Cela indique que l’antenne est bidirectionnelle.
Directivité : La directivité d’une antenne correspond
à son angle d’ouverture. Elle caractérise la façon
dont l’antenne concentre le rayonnement dans une certaine direction de
l’espace.
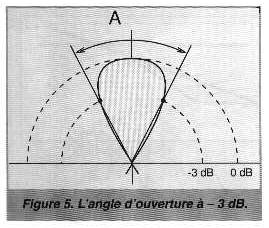
L’angle d’ouverture est exprimé par l’angle A pour lequel, la
puissance rayonnée reste supérieure ou égale à
la moitié de la puissance maximale rayonnée ( si le gain
max = – 3dB) .
Le gain d’une antenne correspond au coefficient multiplicateur par lequel il faut multiplier la puissance d’émission. Ce gain est variable suivant la conception de l’antenne, il est donné en dB.
Avec G= (4p .Pmax)/ P alim
Comme son nom l’indique, il s’agit de l’impédance que possède une antenne. Il faut bien la prendre en compte car il ne faut pas connecter un émetteur ne possédant pas la même impédance. Ce non-respect pourra réduire les performance de l’émetteur ou au pire le détériorer.
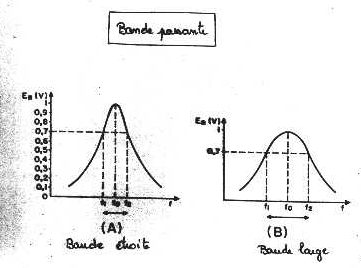
a) Caractéristiques des récepteurs
Pour la réception des radiodiffusion, bien souvent, une simple antenne télescopique suffira si vous vous contentez des plus puissantes (pour améliorer votre connaissance d’une langue par exemple). Dès que vous envisagerez la réception de radios faibles ou lointaines, il faudra utiliser une antenne extérieure, composée d’un simple fil d’une dizaine de mètres, tendu le plus haut possible. Là, les performances du récepteur sont mises à rude épreuve : vous commencerez à entendre des signaux sur des fréquences où vous ne les attendez pas, par mélange de fréquences ou transmodulation. C’est là qu’il est utile de posséder un récepteur de trafic.
Dès le milieu de la gamme, vers 800 à 1000F, vous trouverez des matériels équipés d’un affichage digital de la fréquence, ce qui constitue un atout incontestable. Peu de mécanique, si ce n’est un clavier pour entrer la fréquence de réception, et quelques boutons pour sélectionner le suppresseur de bruits (ANL) ou passer de la modulation d’amplitude (AM, en grandes ondes et sur les ondes courtes) à la modulation de fréquence (FM, de 88 à 108 MHz).
Un peu plus haut dans la gamme, vous trouverez des compromis entre le récepteur " multi-bandes " et le récepteur de trafic. Ces modèles sont dotés d’une position BLU, permettant la réception de stations utilitaires. Sans atteindre la qualité d’un récepteur de trafic, ils donneront le goût de l’écoute aux amateurs.
Il est très sensible, sélectif et parfaitement stable. Il est capable de recevoir tous les modes de modulations : AM, CW, BLU. Voici une liste des accessoires utiles d’un récepteur :
En vogue depuis une dizaine d’année, les nouveaux modèles mis sur le marché sont de plus en plus performant. Ces récepteurs couvrent une très large gamme de fréquences, surtout en VHF et UHF, en AM et FM ou en AM, FM et BLU. De nombreuses stations utilitaires (service urbains, aéronautiques, maritimes, radiotéléphones) émettent en VHF, en particulier entre 60 et 175 Mhz.
Les scanners, comme leur nom l’indique, sont conçus pour balayer
une large bande de fréquences ou de mémoires. Lorsqu’une
émission est détectée, le récepteur se verrouille
dessus, y demeure, ou repart automatiquement, en fonction de la programmation
définie par l’utilisateur. Si les premiers modèles souffraient
parfois de surdité, les matériels qui sortent depuis 2 ou
3 ans sont assez performants pour les écoutes auxquelles on les
réserve.
Le 2eme élément fondamental d’une station radioamateur est bien sur l’émetteur récepteur ou transceiver. Le radioamateur suivant les fréquences qui lui sont attribuées (classe démission) doit utiliser 2 types de transceiver. En effet il existe 2 types émetteurs pour couvrir tout le spectre de fréquence alloué aux radioamateurs
Le 1er type de transceiver couvre les fréquences HF comprises entre 100 khz et 30Mhz. Ce poste est aussi appelé décamétrique. Il possède généralement les modes AM, FM, USB, et pour les hauts de gamme il possède une interface pouvant ,en étant connecté à un PC, recevoir la SSTV ou les faxcimilés. Les derniers modèles intègrent un analyseur de spectres et différents types de filtres numériques permettant une meilleure réception.
Le prix d’un tel poste et d’environ 6000F pour les premiers prix et peut atteindre plus de 20000F.Les principales marques commercialisant se type d’appareil sont KENWOOD, YAESU, ICOM.

Récepteur HF possédant un analyseur de spectres
Le deuxième type de poste destiné aux radioamateurs couvre la bande VHF UHF. Contrairement au décamétrique qui couvre l’ensemble des fréquences, ce type de poste ne couvre que les bandes attribuées aux radioamateurs à savoir :
UHF 430 Mhz à 440 Mhz
Ce type de poste coût environ 4000F à 20000F. Il existe
3 types de poste, la base qui reste a la " maison ", la base mobile qui
peut être intégrer dans un véhicule (voiture, bateaux,
..), et le poste portable de la forme d’un talky-walky .

Transceiver UHF VHF pour base fixe
Principales caractéristiques d’un émetteur récepteur :
La déviation (critère important à respecter
norme fixée par l’administration)
Le pas de scrutation des fréquences
La sensibilité
La puissance d’émission (aussi réglementée)
L’alimentation
Consommation

Transeiver VHF UHF mobile
Un nouveau type d’émetteur récepteur est apparu : Une
interface placée dans un ordinateur permet de le transformer en
tranceiver.
Quelques mots sur l’analyseur de spectre :
Cet instrument de mesure est très utile pour détecter les fréquences qui sont utilisées sur une bande fréquences donnée. Chaque raie (pics) indique qu’une station émet sur cette fréquence. On peut également analyser cette émission pour détecter s’il s’agit d’une modulation FM, AM ou d’une émission d’image TV.
Ce type d’analyse est réservé pour des radioamateurs chevronnés.
VIII)
Propagation des ondes suivant les plages de fréquences
1) Propagation des ondes HF, MF et LF
Les ondes LF (ou ondes kilométriques) se propagent de la même façon le jour et la nuit. Elles contournent les obstacles et l’énergie de l’onde au sol (énergie qui s’étale à la surface de la terre) parvient parfaitement à tous les points compris dans le rayon d’action quelque soit l’heure et le lieu. L’énergie émise vers la verticale est perdue, ce qui amène à favoriser le rayonnement horizontal de l’antenne émettrice.
Les ondes MF (ou ondes hectométriques), et plus précisément leurs ondes au sol, sont d’autant plus absorbées par les obstacles que leurs longueur d’onde décroît. Elles se propagent le jour comme la nuit par une onde au sol, qui est entièrement absorbée au bout de plusieurs centaines de kilomètres. Avec l’arrivé de la nuit, on observe une propagation par réfraction dans les couches de la ionosphère. Cette propagation, qui s’accentue d’autant plus que la nuit tombe, va permettre de porter l’énergie à plusieurs milliers de kilomètres de l’émetteur. On peut d’ailleurs noter que lorsque les deux ondes (au sol et réfractée) sont à égalité d’amplitude, un phénomène de distorsion apparaît. En effet, la distance parcourue par l’onde réfractée est plus importante que celle parcourue par l’onde au sol, elle arrive donc en retard par rapport à l’onde au sol. Une fois l’onde réfractée devenue la plus forte, ce phénomène disparaît.
Pour les ondes HF (ondes décamétriques), l’onde au sol est très rapidement absorbée par les obstacles quelque soit la puissance du signal. La seule onde qui sera alors captable est l’onde réfractée. Comme précédemment, la réfraction à lieu sur une couche de la ionosphère. L’onde est réfractée vers le point R1( voir figure page suivante ) où il peut y avoir réflexion sur le sol ce qui renvoie l’émission vers la couche ionisée et on a donc à nouveau une réfraction qui renvoie l’onde vers le point R2, et ainsi de suite. La ionosphère comporte plusieurs couches à des altitudes et avec des densités différentes. On trouve notamment la couche E située vers 100 à 110 km et une couche F se trouvant à 300 km. Cette dernière se dédouble en été en deux couches F1 et F2 situées respectivement à 225 et 320 km. Durant les journées hivernales, la couche F se limite à la couche F2 située à 225 km. Entre 60 et 100 m, les ondes peuvent avoir une portée de plusieurs milliers de kilomètres au cours de la nuit. Les ondes de 40 à 50 m peuvent assurer des transmissions diurnes de quelques centaines de km et de quelques milliers de km durant la nuit. Vers 20 à 30 m, la distance du point R1 à l’émetteur (c’est à dire la distance de saut) s’allonge, ce qui permet des liaisons avec le monde entier. Au-dessous de 20 m, l’augmentation de l’angle de réfraction peut rendre la réfraction inutile puisque l’onde " n’accrochera " pas la surface terrestre. On peut d’ailleurs ajouter que l’ionisation dépend de l’activité solaire : cycle de 11 ans, rayonnement corpusculaire, ...).
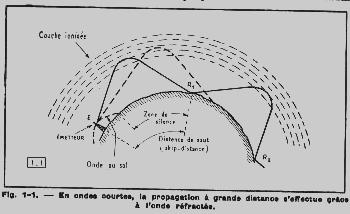
2) Propagation des ondes VHF et UHF
On utilise pour la réception des antennes à éléments
parasites. On peut régler différents paramètres :
nombre d’éléments parasites, longueur des éléments,
espacement entre éléments,... La conception de l’antenne
dépend des résultats souhaités : une bande plus large
entraîne une chute du gain, un meilleur rapport gain avant/gain arrière
nécessite un agencement différent que pour un gain avant
maximum. La qualité de l’antenne dépend ensuite du constructeur
et de son emplacement.
Nous remercions plus particulièrement, le REF-UNION
pour nous avoir fournit les textes de législation et de technique
des radioamateurs, ainsi que le radio-club de Vineuil, rue des écoles
espace loisir art et culture, pour nous avoir accueillis dans leurs locaux
et pour l’attention qu’ils ont porté à nous présenter
les différents modes de trafic du radioamateurisme.
Ó Copyright Anthony Bourguignon Nicolas Da Silva Frédérique Thauvin