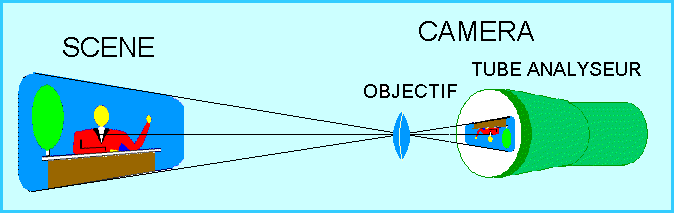
Dans un appareil photographique,
un objectif projette l'image de la scène à transmettre sur la
pellicule à sensibiliser.
Cette image est bien plus petite que la scène et se trouve inversée
par l'effet du croisement des rayons au centre optique de l'objectif.
Nous
pourrions en dire autant de l'oeil, son cristallin et la rétine.
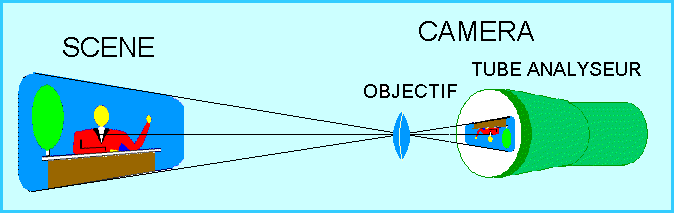
|
A l'intérieur
du tube, un faisceau électronique balaye très rapidement
toute la surface de l'image projetée, en l'analysant suivant 625
lignes horizontales tous les 1/25 ème de seconde. Ce qui correspond
naturellement à 25 images par seconde (le cinéma est à
24 images par seconde).
Un rapide calcul vous montrera que le balayage de chaque ligne dure 64 microsecondes. |
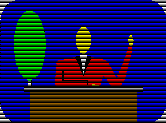 |
Le système électronique d'analyse du tube permet de générer à tout instant du balayage, une tension proportionnelle à l'intensité lumineuse du point de l'image sur lequel se trouve le faisceau.
Comme on veut reproduire les couleurs, il faut décomposer la lumière de chacun des points de l'image en ses trois composantes primaires : Rouge, Vert, Bleu - dites composantes RVB.
Ce sont donc trois tensions, proportionnelles aux trois composantes chromatiques de chaque point qui sont générées par des dispositifs de tubes analyseurs dont la description dépasse le cadre de cette étude.Le signal vidéo est donc, à l'origine, constitué par trois signaux de couleur R V B.
Pour celux qui ne distingueraient pas les couleurs (daltoniens) et aussi pour les téléviseurs monochromes (improprement appelés noir et blanc) on a recours à une combinaison des composantes chromatiqes RVB appelée la luminance.
|
Luminance
|
|
y = 0,33 R +
0.59 V + 0.11 B
|
Ces proportions ont été choisies sur des critères physiologiques : le vert semble toujours plus lumineux que le rouge qui l'est plus que le bleu. Sans cette pondération, un drapeau rouge, vert bleu de mêmes intensités apparaitrait comme uni : ce qui n'est pas conforme à la perception commune.
Dans une transmission à distance, on préfère transmettre la liminance plus deux autres signaux appelés chrominances.
|
Chrominances
|
|
|
R' = R - y
|
B' = B- y
|
Analyse par lignes horizontales - balayage -Pourquoi définir ainsi les signaux de chrominance ?.
La rétine est constituée de bâtonnets nombreux et sensibles à la luminance, pas aux couleurs, et, en même temps de cônes, rares mais sensibles aux couleurs. Les cônes nécessitent pour fonctionner des luminances importantes. Voilà pourquoi "la nuit tous les chats sont gris".
Lors d'une transmission vidéo une bande passante suffisante doit être allouée à la luminance puisque c'est le signal auquel la rétine est le plus sensible.
En revanche, une bande beaucoup plus étroite étroite suffit pour transporter les chrominances R' et B' auxquelles l'oeil est peu sensible.Par ailleurs, on a constaté que, pour la plupart des images, les signaux de chrominance R' et B' sont beaucoup plus faibles que y, R, ou B. (les images courantes sont peu colorées).
On met cela à profit en transportant la luminance sur la porteuse principale (voir Transmission large bande - modulation) et les signaux de chrominance R' et B' sur une porteuse secondaire, la sous-porteuse, modulée en fréquence pour SECAM, en phase pour NTSC ou PAL et ce à l'intérieur de la bande passante de la luminance. C'est pourquoi, pour calculer la bande passante du signal vidéo, nous ne tiendrons pratiquement compte que de la luminance.
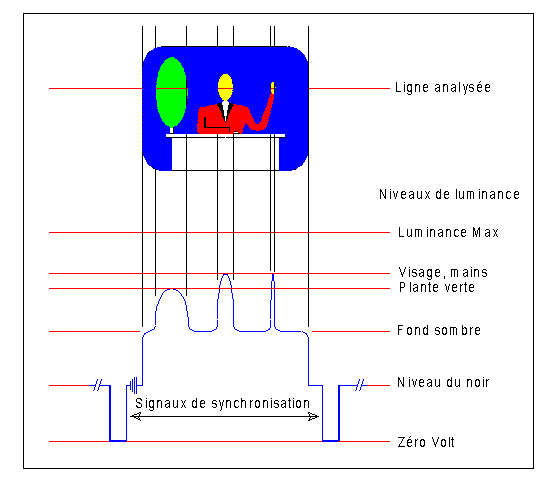
En bleu, le signal Vidéo de Luminance
La caméra et le téléviseur travaillent en synchronisme. L'électronique du téléviseur projette à chaque instant, le point analysé par la caméra à l'endroit correspondant de la scène télévisée et avec les mêmes intensités des composantes R, V et B. Il y a synchronisme spatial entre la scène et l'écran avec un retard constant dû à la transmission. Les points ainsi créés sur l'écran s'appellent des "spots" .
Le téléviseur place les spots en balayant l'écran de gauche à droite suivant des lignes .
En fin de ligne, le spot revient à gauche mais un peu plus bas pour tracer la ligne suivante. Il finit ainsi par couvrir de lignes tout l'écran.
Arrivé à la dernière ligne en bas de l'écran, il a terminé une "trame". Il revient en haut à gauche pour en tracer une nouvelle.
Dans le standard actuel de télévision, la durée de blayage complet d'une ligne est de 64 microsecondes.
Ce qui correspond à une fréquence de 15 625 lignes / seconde.En réalité, le balayage est réalisé de manière un peu plus compliquée qu'il n'a été dit plus haut.
Une image est l'ensemble de deux trames "entrelacées" sucessives.
Dans la figure ci-dessous, nous avons dessiné en bleu la trame dite impaire car elle contient les lignes 1, 3, 5, 7, etc... 625
Nous avons dessiné en rouge la trame dite paire car elle contient les lignes 2, 4, 6, 8, etc... 624.
Ces couleurs n'ont rien à voir avec les couleurs de l'image.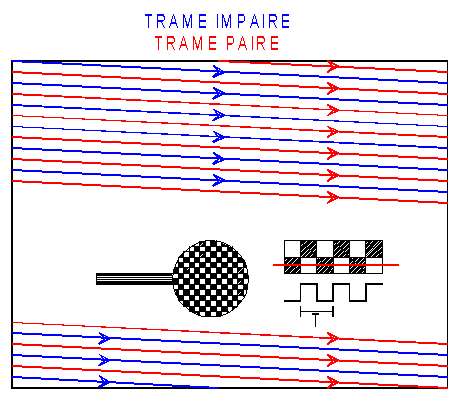 Note pour les curieux : Pourquoi des trames entrelacées ?La "finesse" de restitution de l'image télévisée a été définie, au moment où les standards ont été fixés, sur des considérations de résolution de l'oeil du spectateur placé à une certaine distance standard de l'écran. Dans ces conditions, 625 était le nombre de lignes limite pour assurer une vision nette des images. Dans les conditions actuelles avec, notamment, avec des téléviseurs plus grands regardés d'assez (trop) près, cette définition est faible et, commercialement, on incite à la nouvelle TVHD (Télévision à Haute Définition). Il est toutefois utile de rappeler, qu'à l'époque, la France s'était dotée d'un réseau plus fin de 819 lignes.
Note pour les curieux : Pourquoi des trames entrelacées ?La "finesse" de restitution de l'image télévisée a été définie, au moment où les standards ont été fixés, sur des considérations de résolution de l'oeil du spectateur placé à une certaine distance standard de l'écran. Dans ces conditions, 625 était le nombre de lignes limite pour assurer une vision nette des images. Dans les conditions actuelles avec, notamment, avec des téléviseurs plus grands regardés d'assez (trop) près, cette définition est faible et, commercialement, on incite à la nouvelle TVHD (Télévision à Haute Définition). Il est toutefois utile de rappeler, qu'à l'époque, la France s'était dotée d'un réseau plus fin de 819 lignes.
Pour des raisons de bande passante, de continuité apparente des mouvements et de compatibilité au cinéma, on est amené à passer 25 images par seconde. Si on n'entrelaçait pas, nos yeux recevraient 25 éclairs par seconde correspondant à chaque image. Cela se traduirait par un scintillement insupportable. On a décidé de "saucissonner" (déjà) l'image ligne par ligne. Une ligne sur deux est attribuée à une trame, la trame suivante étant constituée des lignes entrelacée ne faisant pas partie de la précédente. On a ainsi 50 trames par seconde - cinquante éclairs moins gênants que 25 (quoique) - mais le nombre d'images par seconde reste 25.
Calculons la bande passante de l'image télévisée au standard 625 lignes et à 25 images par seconde.
Imaginons l'image la plus fine que l'on puisse passer sur un écran.
C'est un damier noir et blanc dont les côtés des cases ont la hauteur d'une ligne.
Le damier aura 625 cases en hauteur.Les dimensions d'un écran étant dans les proportions de 4/3 Une ligne contiendra 625 * ( 4 / 3 ) = 833 carrés.
Une image contiendra 625 * 833 = 520 625 carrés
Pour 25 images par seconde on aura : 520 625 * 25 = 13 015 625 carrés par seconde.La période de la fondamentale d'un tel signal s'étend sur deux carrés, noir et blanc, consécutifs. Voir figure ci-dessus.
La fréquence du signal vidéo sera donc de 13 015 625 / 2 = 6 507 812. Soit 6,5 MHz environ.Telle est la bande passante de l'image télévisée monochrome.C'est aussi celle de la télévision en couleurs vu que les procédés de sous-porteuse permettent d'ajouter les chrominances sans élargissement de la bande passante.
Retour au carrefour précédent "Physique et représentation des données" Retour au carrefour "Réseaux"